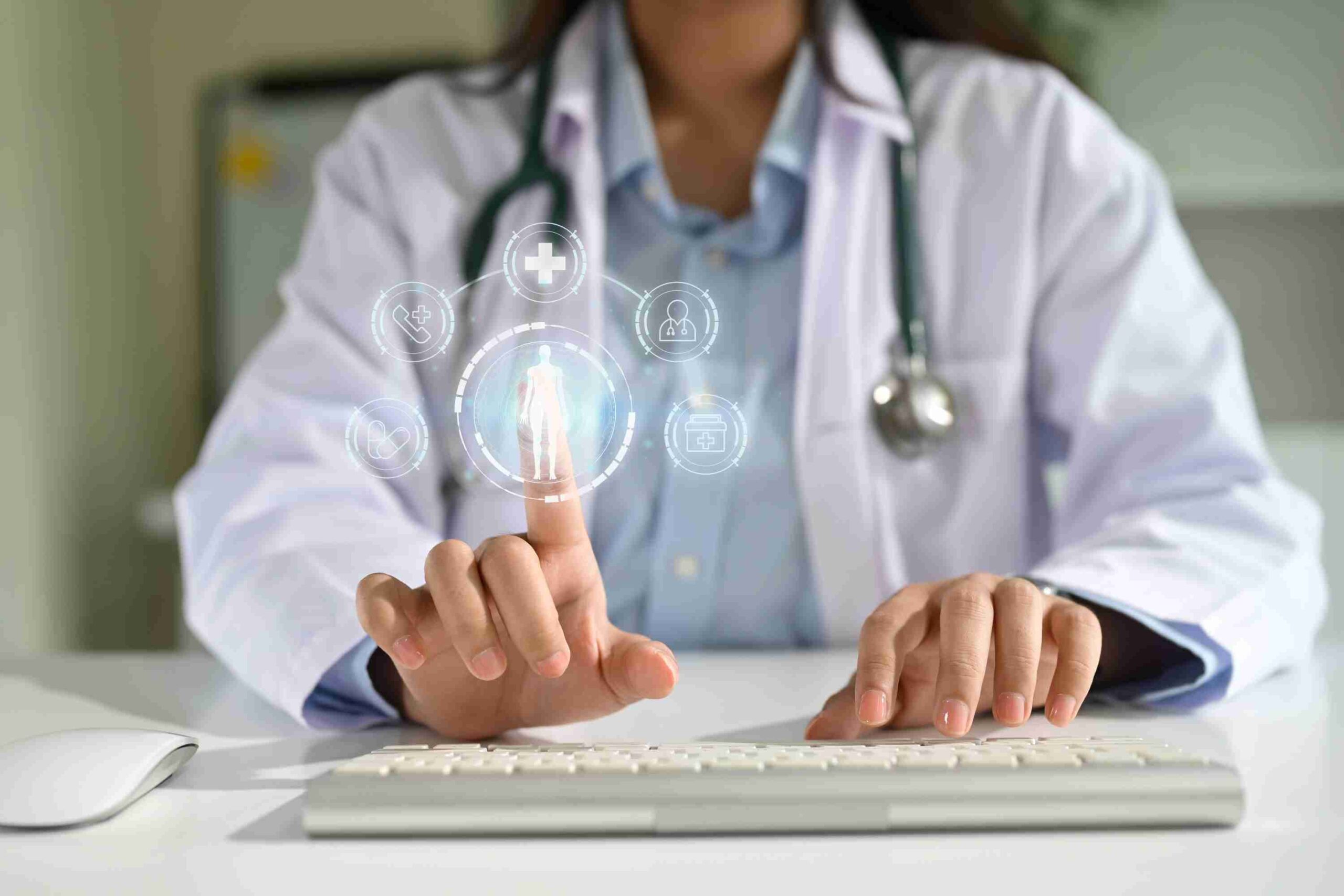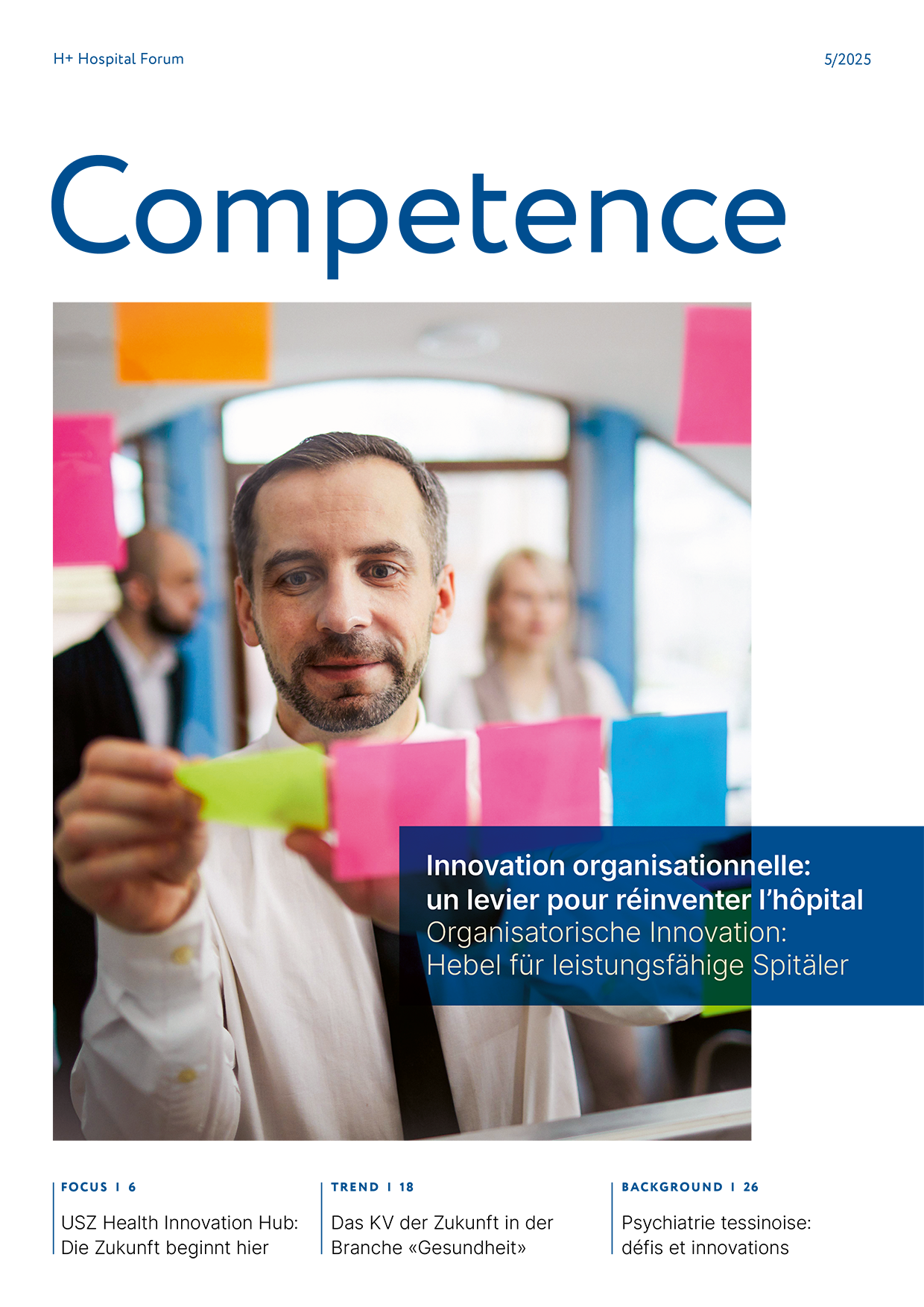7 min
7 minFocus
Patrice Hof: «On attend des hôpitaux un rôle d’exemplarité»
Pourquoi s’est-on autant compliqué la tâche en Suisse, avec ces multiples communautés, ces plateformes techniques différentes ?
La santé est gérée de manière décentralisée en Suisse: la fourniture de soins est une affaire des cantons et des prestataires privés, dans une logique libérale, il n’était pas question de centraliser. La Confédération imaginait alors que pour chaque hôpital un système local serait mis en place, on s’attendait à voir 20 à 30 communautés fleurir en Suisse. Cela ne s’est pas passé ainsi, car en s’attelant à cette tâche, l’ensemble des acteurs a constaté la complexité et le coût d’un tel système.
CARA représente tous les cantons romands, sauf Neuchâtel. Pour quelles raisons?
Les discussions en Suisse romande, basées sur l’expérience de Genève qui a été précurseur en la matière en créant son propre système bien avant le DEP, ont démontré à quel point il était exigeant de mettre en place un tel processus. Lorsque les cantons romands ont souhaité s’unir pour réaliser cela, Neuchâtel ne partageait pas l’approche des autres cantons, ce qui l’a conduit à créer son propre système.

Comment les choses se passent-elles en Suisse alémanique?
Trois communautés de référence régionales existent. Dans cette approche libérale, le DEP reste un marché concurrentiel. En Suisse romande, on ne perçoit pas forcément cela.
Pourquoi la Suisse romande est-elle en avance sur le reste de la Suisse?
La majorité des dossiers ouverts a longtemps été en Suisse romande. Au niveau national, proportionnellement à la population, nous restons majoritaires. Lorsque l’on analyse les institutions de santé affiliées, sur 4200 pour l’ensemble du territoire, 3200 sont chez CARA. La participation des institutions est très importante, car pour que le DEP soit utile, il faut que les professionnel·le·s puissent inscrire des informations dans le dossier: sans cela, le DEP n’est qu’une simple page blanche, un dossier vide. Chez CARA, nous mettons un point d’honneur à travailler sur tous les tableaux, la satisfaction des patient∙e∙s est primordiale. Et pour ce faire, il faut qu’elles et ils puissent utiliser leur dossier, que ce dernier soit documenté par des professionnel∙le∙s et des institutions affilié∙e∙s à CARA. Aujourd’hui, nous comptabilisons près de 3 millions de documents, plus des deux tiers sont publiés automatiquement par les systèmes intégrés des hôpitaux.
Les hôpitaux ont l’obligation de participer au DEP depuis le 15 avril 2021. Pourtant, de nombreux établissements n’ont toujours pas franchi le pas. Comment expliquez-vous cela?
Oui, c’est effectivement le cas, surtout en Suisse alémanique. En Suisse romande, tous les hôpitaux disposant de lits LAMal sont affiliés. Légalement, les hôpitaux ont l’obligation d’être affiliés à un système DEP. Mais quel canton va retirer un hôpital de sa liste hospitalière parce qu’il ne participe pas au projet? Comme certains cantons alémaniques n’ont pas été très soutenants au départ, ils ne pouvaient pas sanctionner leurs établissements.
En Suisse romande, les cantons ont pris les devants, ils ont soutenu politiquement et financièrement le projet, alors que la loi ne les y obligeait pas.
Les Romands ont estimé qu’il s’agissait d’une tâche de santé publique et qu’il était de leur devoir de prendre en charge les investissements nécessaires pour mettre en place le système.
Seul·e·s un peu plus de 50000 Suisse·sse·s sur neuf millions d’habitant·e·s ont ouvert un DEP. Pourquoi, selon vous, la population n’est-elle pas plus enthousiaste?
Les personnes qui ont connaissance et besoin du DEP sont ravies. Par le passé, elles devaient passer par tous les professionnel·le·s rencontré·e·s pour récolter ces données, un véritable chemin de croix. Le faible taux d’ouverture du DEP est dû au fait que les gens ne savent pas que cet outil existe. La campagne d’information prévue par la Confédération est sans cesse repoussée depuis deux ans.
De plus, beaucoup de médecins traitants ne franchissent pas le pas…
Oui, c’est un fait. L’une des raisons? À l’heure actuelle, sur le plan technique, leur logiciel de cabinet n’est, en général, pas intégré au DEP. Cela les oblige à saisir deux fois les informations. Ce n’est pas pratique ni viable, je comprends leur réticence à se lancer. Les défis en termes techniques et sécuritaires sont très élevés. De lourds investissements sont nécessaires pour que tous les éditeurs de logiciels puissent faire les adaptations.
30 millions, ce n’est donc pas assez.
Non, bien sûr, c’est loin d’être le cas! Même si vous prenez le programme DigiSanté avec 400 millions sur 10 ans, c’est encore 10 fois insuffisant. Si l’on veut vraiment que ça fonctionne, il faut se donner les moyens de le faire. Numériser le système de santé, c’est aussi changer les pratiques quotidiennes dans les hôpitaux et les cabinets. Ce n’est pas une question technique, mais une question de santé publique. Ce n’est pas uniquement en adaptant un logiciel que l’on change de paradigme.
Les études démontrent que si l’on veut un retour sur investissement en termes cliniques, si l’on veut optimiser les prises en charge, éviter les examens inutiles, etc., il est nécessaire que la majorité de la population et des prestataires de soins l’utilise.
Et pour ce faire, il faut investir massivement pour que cela fonctionne sur l’ensemble du territoire. Cela ne se compte pas à l’échelle d’une législature: il faudra attendre vingt ans avant d’avoir un retour sur investissement.
Cela reste énormément d’argent pour un outil électronique…
Ce n’est pas un outil électronique: c’est un outil de santé. Pour moi, le DEP est une infrastructure. On peut le comparer au rail: le réseau ferroviaire suisse ne s’est pas fait en cinq ans. Pour qu’il fonctionne, des investissements massifs ont dû être réalisés. A mon avis, peu de gens l’ont malheureusement compris à ce jour. Aujourd’hui, la contribution financière des cantons à CARA représente seulement 0,26% de leur financement direct du système de santé.

De votre point de vue, la Confédération devrait-elle davantage s’impliquer?
Oui, un pilotage central plus actif et plus efficace permettrait de faire avancer les choses plus rapidement. Dans la loi actuelle, certains aspects complexifient inutilement le système. Une révision urgente a eu lieu, mais l’essentiel des modifications n’interviendra pas avant 2028.
On attend de la Confédération qu’elle joue un rôle beaucoup plus important dans l’exploitation du DEP.
Nous proposons d’instaurer une unique infrastructure technique unique opérée par la Confédération et mise à disposition des différentes communautés. Le fait qu’à l’heure actuelle chaque communauté gère son infrastructure technique ne fait pas de sens et génère des coûts et de la complexité inutiles.
Que devraient faire les hôpitaux pour davantage jouer le jeu?
Je pense à l’exemple du CHUV qui écrit systématiquement à chacun·e de ses patient·e·s bénéficiant d’une opération programmée pour l’inciter à ouvrir un DEP. La meilleure publicité qui est faite pour le DEP est celle qui émane directement des professionnel·le·s de santé. On attend des hôpitaux un rôle promoteur, précurseur, un rôle d’exemplarité. C’est un point capital: si l’hôpital joue le jeu, le médecin de ville et l’infirmière à domicile par exemple ont immédiatement accès aux données, dès la sortie de la·du patient·e, sans délai. Un véritable atout pour faciliter les transitions entre les différents prestataires qui peuvent parfois être délicates. Cela renforce grandement la sécurité du parcours de la·du patient·e et, la sécurité des soins.
Infographie: eHealth Suisse