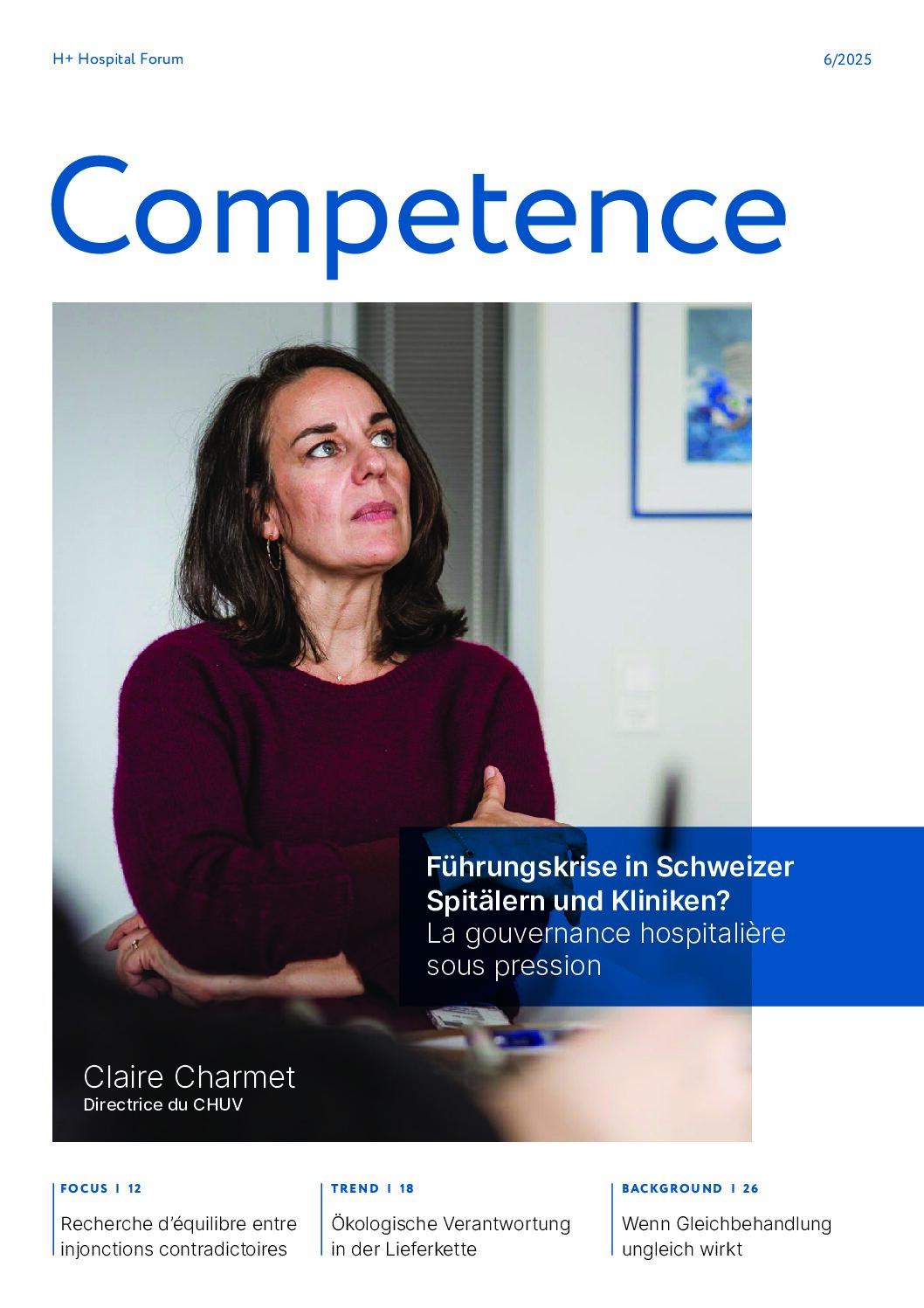5 min
5 minFutur des hôpitaux et des cliniques
L’hôpital sort de ses murs pour mieux soigner
«Je suis tout à fait satisfait de ce que l’on a déjà accompli depuis un an. Mais évidemment, je pense qu’il faut accélérer le tempo.» À la tête du conseil d’administration du RHNe depuis mars 2024, le professeur Philippe Eckert n’élude pas les défis. La situation financière reste tendue (un déficit de 30 millions est attendu cette année encore), mais le chantier est bien plus vaste. Pour lui, c’est tout le rôle de l’hôpital dans le système de santé qui est à repenser.
Le modèle centré sur l’hôpital, qui impose à la·au patient·e de venir systématiquement se faire soigner sur place, ne tient plus.
«Il est plus que jamais nécessaire de sortir de l’hospitalocentrisme. Cela ne veut pas dire que l’hôpital n’a plus sa place dans le système de santé de demain, au contraire.» L’hôpital ne doit plus être un îlot, mais s’insérer dans un tissu coordonné de soins, en interaction constante avec les professionnel ·le·s de la santé, les soins à domicile, les structures de première ligne. Le but: garantir une prise en charge globale, fluide et continue. «Un·e patient·e a un parcours de santé avant d’entrer à l’hôpital, et un autre après. C’est cette continuité qu’il faut organiser.»
Proximité, souplesse et complémentarité
Une transformation d’ampleur qui ne se décrète pas du jour au lendemain. «C’est un changement de posture, une forme de nouvel apprentissage, y compris pour les médecins. Nous avons été formés à rester à l’hôpital, à accueillir, à soigner. Il faut désormais apprendre à sortir des murs.» Et cela suppose un engagement clair des directions hospitalières, mais aussi des incitations concrètes: «Il faut amener des solutions contractuelles, soutenir les médecins hospitaliers dans cette évolution.» Cette mutation passe par la création de centres de santé délocalisés, où l’hôpital joue un rôle de suppléance, sans entrer en concurrence avec les acteur·rice·s privé·e·s. «Là où les besoins sont couverts, il n’est pas nécessaire que l’hôpital intervienne.»

Mais dans les zones sous-dotées, il peut proposer des consultations spécialisées, monter des permanences ou des équipes mobiles, en gériatrie, en réadaptation ou en soins palliatifs par exemple.» Ces centres peuvent aussi réunir différentes professions de santé: médecins de premier recours, spécialistes, physiothérapeutes, infirmier·ère·s, pharmacien·ne·s, etc., dans une logique de coordination étroite.
Pour l’ancien directeur du CHUV, cette évolution bénéficie aussi bien aux patient·e·s qu’aux professionnel ·le·s: «Le virage ambulatoire diminue les risques d’infection et de déconditionnement; il permet de mieux répondre aux aspirations des soignant·e·s, qui souhaitent concilier vie professionnelle et vie privée.»
En concentrant les soins ambulatoires sur les heures ouvrables, on allège la pression sur les équipes de garde.
Mais encore faut-il adapter les horaires d’ouverture de ces structures: «Dès qu’on sort des heures ouvrables, tout le monde se retrouve à l’hôpital, même pour des cas bénins. Il est essentiel que les permanences soient accessibles le soir, le week-end.»
Une réponse transversale à la pénurie
L’un des principaux défis reste la pénurie de personnel. «On ne mesure pas encore à quel point elle va s’aggraver, avertit l’expert. Toutes les projections sont alarmantes. Il est indispensable de créer des synergies, de renforcer l’efficience du système.» Pour le professeur, la réponse n’est pas dans la concurrence, mais dans la complémentarité: «Il faut éviter de gaspiller des ressources humaines, créer des systèmes collaboratifs où chacun·e apporte ses compétences.»

Cela passe aussi par une réduction de la charge administrative, qui freine aujourd’hui l’activité clinique. «Nous devons libérer les soignant·e·s de tâches bureaucratiques pour leur permettre de se recentrer sur leur coeur de métier.» L’optimisation passe par une meilleure gouvernance, mais aussi par des outils numériques partagés. «Développer un système informatique commun à toutes les structures est une priorité. C’est le socle d’une coordination efficace.»
La transition est en cours à Neuchâtel, où le RHNe participe à la structuration d’un réseau de santé innovant. La prise de participation dans le groupe Santé Volta s’inscrit dans cette logique.
«Nous avons déjà quatre centres de santé dans le canton, notre volonté est claire: continuer à les développer.» Le lien avec les établissements médico-sociaux est aussi un axe fort. «Trop de patient·e·s âgées restent à l’hôpital faute de place adaptée. Nous devons pouvoir médicaliser davantage les EMS.»
L’innovation comme réponse à la crise
Or cette transition a un coût que les tarifs actuels ne couvrent pas. «Le système tarifaire est un frein, incontestablement. Mais il va évoluer, notamment avec la réforme EFAS. En attendant, il faut que l’État soutienne financièrement ces initiatives. Et à Neuchâtel, la volonté politique est là. Les échanges avec le canton sont très positifs.»
Face à l’ampleur des défis (crise financière, pénurie de main-d’oeuvre, vieillissement de la population, etc.), Philippe Eckert garde une posture lucide mais résolument tournée vers l’action: «Je suis optimiste de nature. Mais l’heure est à la réinvention. Le système hospitalier est en crise, certes. N’oublions pas que rien ne fait évoluer plus vite un système qu’une crise. Celles et ceux qui anticipent, qui innovent, qui osent, s’en sortiront le mieux.»
Cédit photo: Philippe Eckert (crédit: Guillaume Perret)