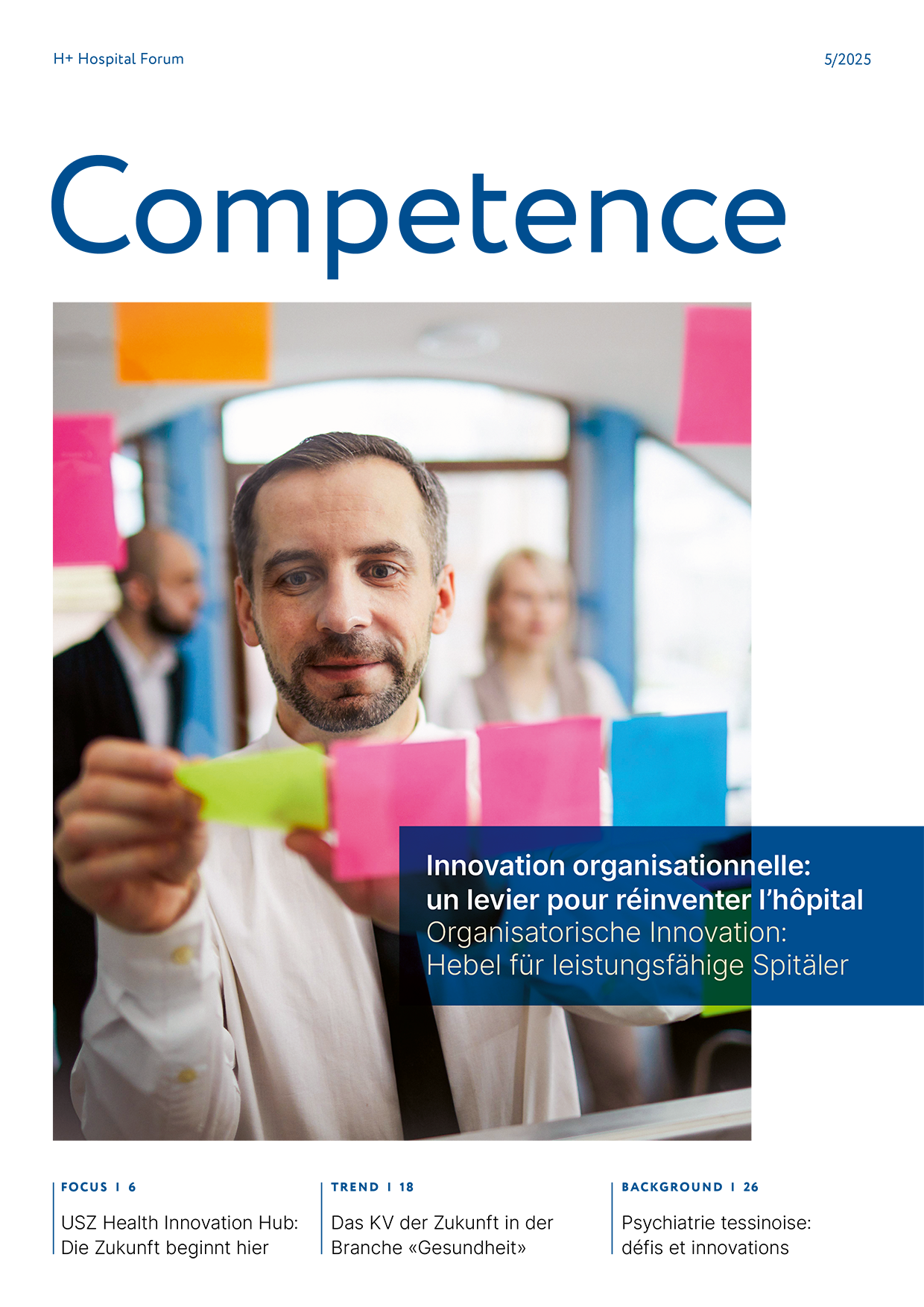6 min
6 minInterview
«Les expériences personnelles sont essentielles pour défendre les droits des patient∙e∙s»
Madame Woods, vous êtes membre de EUPATI Suisse et avez suivi la formation de Patient-Expert, mais vous vous définissez comme patient·e-partenaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie exactement et quel rôle joue un·e patient·e-partenaire dans le système de santé?
Un∙e patient∙e-partenaire est une personne qui apporte des connaissances issues de son expérience personnelle vis-à-vis de la maladie. Cela leur permet de contribuer avec des perspectives souvent négligées dans les milieux cliniques traditionnels, en veillant à ce que la voix des patient∙e∙s soit intégrée dans les processus de décision. Elles et ils collaborent avec les professionnel∙le∙s de la santé pour améliorer la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des services et de la recherche.
En partageant leurs expériences vécues, les patient∙e∙s-partenaires peuvent identifier des lacunes dans les soins, promouvoir la communication et aboutir à des résultats centrés sur la∙le patient∙e.
Avant de devenir patient∙e∙s-partenaires, les individus passent généralement par un processus d’autonomisation et s’engagent pour les autres, souvent au sein de leur propre communauté de patient∙e∙s ou même d’autres communautés. Elles et ils peuvent aussi suivre des formations en communication, méthodes de recherche et compétences en santé, telles que la formation de Patient Expert de EUPATI CH, pour enrichir encore leur contribution.

Le thème du Forum suisse des patient∙e∙s cette année pose la question de l’intervention des patient∙e∙s. D’après votre expérience, dans quels domaines l’implication des patient∙e∙s fait-elle encore défaut?
Tout d’abord, il faut distinguer le terme général d’«intervention» et la participation active des patient∙e∙s dans les processus décisionnels. L’objectif est de collaborer et de favoriser l’échange de connaissances pour aboutir à une amélioration des soins, tant dans le domaine de la santé que dans la recherche. Les domaines où l’implication des patient∙e∙s pourrait encore être optimisée sont nombreux. Je pense notamment à la prise de décision en matière de thérapie, l’élaboration de plans de traitement, les mécanismes de retour d’expérience, les formations conjointes pour le personnel et les patient∙e∙s, ainsi que l’accessibilité à l’information.
Pourriez-vous nous donner un exemple concret?
Souvent, des idées prometteuses ne sont pas pleinement mises en œuvre par manque de structures adéquates et d’ouverture au changement de la part des décideurs. Prenons l’exemple du mécanisme de retour d’expérience: bien que tous les hôpitaux disposent de services pour recueillir les retours, combien prennent réellement contact avec celles et ceux qui le souhaitent?
Cela fait 21 ans que je me rends fréquemment à l’hôpital: je n’ai jamais été contactée après mes séjours, bien que je l’aie demandé. En tant que partenaire-patiente, je sais que les hôpitaux cherchent à répondre aux critiques, mais souvent ces données restent en interne, sans communication externe.
Mon expérience vécue et mes échanges avec d’autres patient∙e∙s me permettent d’affirmer que cette boucle de retour d’information ne fonctionne pas et nuit à la confiance et à la réputation des établissements de soins.
Quel rôle devraient jouer les cliniques et hôpitaux dans ce processus?
Les hôpitaux doivent avant tout veiller à une bonne gestion de la qualité et à une communication transparente vers l’extérieur. Pour favoriser l’implication des patient∙e∙s, il est d’abord nécessaire de changer de mentalité, de créer les structures requises et de fournir les ressources nécessaires. Prenons un exemple: supposons qu’un hôpital élabore une nouvelle stratégie et souhaite inclure les patient∙e∙s. Dans l’état actuel, la stratégie est conçue d’abord en interne avant de solliciter les patient∙e∙s à la fin du projet. Ne serait-il pas préférable de les impliquer déjà en amont?
Les cliniques et les hôpitaux doivent impliquer les patient∙e∙s dès le début et structurer le processus pour qu’il soit adapté à ces derniers∙ères.
Si les établissements ne savent pas comment s’y prendre, ils peuvent s’inspirer du «Modèle de Montréal pour la participation des patient∙e∙s et du public» ou «Apprendre ensemble: un cadre d’évaluation de l’engagement des patients et du public (EPP) en recherche». Il est également utile de faire appel à des patient∙e∙s-partenaires expérimenté∙e∙s pour favoriser la communication, former de nouveaux partenaires, développer des mécanismes de retour d’expérience et organiser des formations.
Comment l’implication des patient∙e∙s peut-elle modifier le parcours de soin?
Je citerais plusieurs aspects: amélioration de la satisfaction des patient∙e∙s, meilleure acceptation des traitements, adaptations individualisées, meilleure communication, détection précoce des problèmes, augmentation du succès des thérapies, développement de la confiance et retour d’expérience pour les améliorations.
Militez-vous pour une formation des patient∙e∙s afin qu’elles et ils puissent s’impliquer plus activement?
Oui, absolument. Les patient∙e∙s doivent aussi changer leur façon de penser, développer une vision globale et passer du micro au méta-niveau. Je suis convaincue que pour obtenir du changement, il faut s’impliquer activement et ne pas se reposer sur les autres. La beauté de l’implication des patient∙e∙s et des proches réside dans le fait que chacun∙e peut participer selon ses moyens, que ce soit dans un rôle informatif, consultatif, collaboratif ou de direction. Mais ces rôles doivent être clairement définis au préalable.
Quels obstacles freinent aujourd’hui la prise d’un rôle plus actif des patient∙e∙s dans leur traitement?
Parmi les obstacles, on trouve le manque de connaissance sur les maladies et les options de traitement, le système de santé qui ne prévoit pas suffisamment de temps pour laisser un peu de place aux questions, une communication insuffisante et la crainte de l’autorité.
Souvent, il n’y a pas non plus le soutien adéquat ni les bonnes personnes pour aider les patient∙e∙s à s’engager activement; les patient∙e∙s-partenaires pourraient jouer un rôle précieux à cet égard.
Vous souffrez vous-même d’une maladie grave. Où puisez-vous la force de vous engager pour les droits des patient∙e∙s?
Un dicton qui me correspond bien est le suivant: «La nécessité est mère de l’invention». Face à ma situation, je transforme ce que j’ai vécu en quelque chose de positif pour aider les autres. Cette expérience m’enrichit et m’aide à surmonter mes propres défis. Ma motivation principale est mon instinct de survie, qui me donne la force de passer à l’action et de m’engager. Je sais que j’ai des connaissances que l’autre n’a peut-être pas, et cet écart peut être vital dans des situations critiques. C’est ce qui me pousse à aller de l’avant, plutôt que d’attendre que quelqu’un d’autre le fasse à ma place.
Swiss Patient Forum 2024 d’EUPATI Suisse
Cette année, le Swiss Patient Forum est placé sous la devise: «Patient·e·s prêt·e·s à intervenir: définir nos rôles à tous les niveaux».
L’intégration des patient·e·s dans les organes, les conseils consultatifs et les processus de décision du système de santé suisse – que ce soit dans la recherche clinique, les associations ou l’industrie – prend de plus en plus d’importance. Pour pouvoir assumer efficacement ce rôle, les patient·e·s ont besoin d’une formation et d’un soutien ciblés. Cette année, le Swiss Patient Forum se concentre précisément sur ces aspects. Jennifer Woods s’exprimera lors de la manifestation.
Samedi 16 novembre 2024, 13h454, Stad Wankdorf à Berne.
Inscription et informations via le site web d’Eupati
Photo de titre: via Canva.com