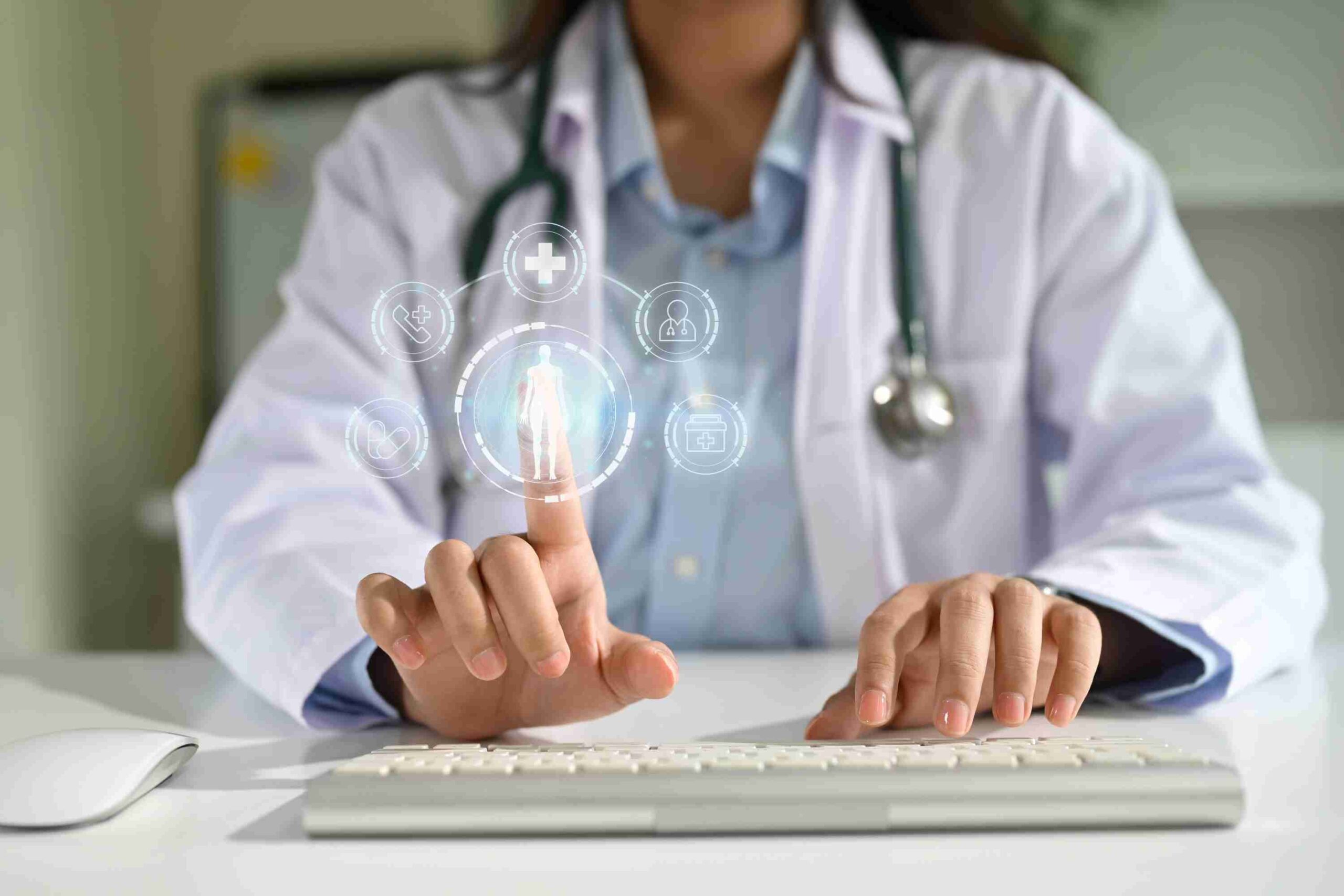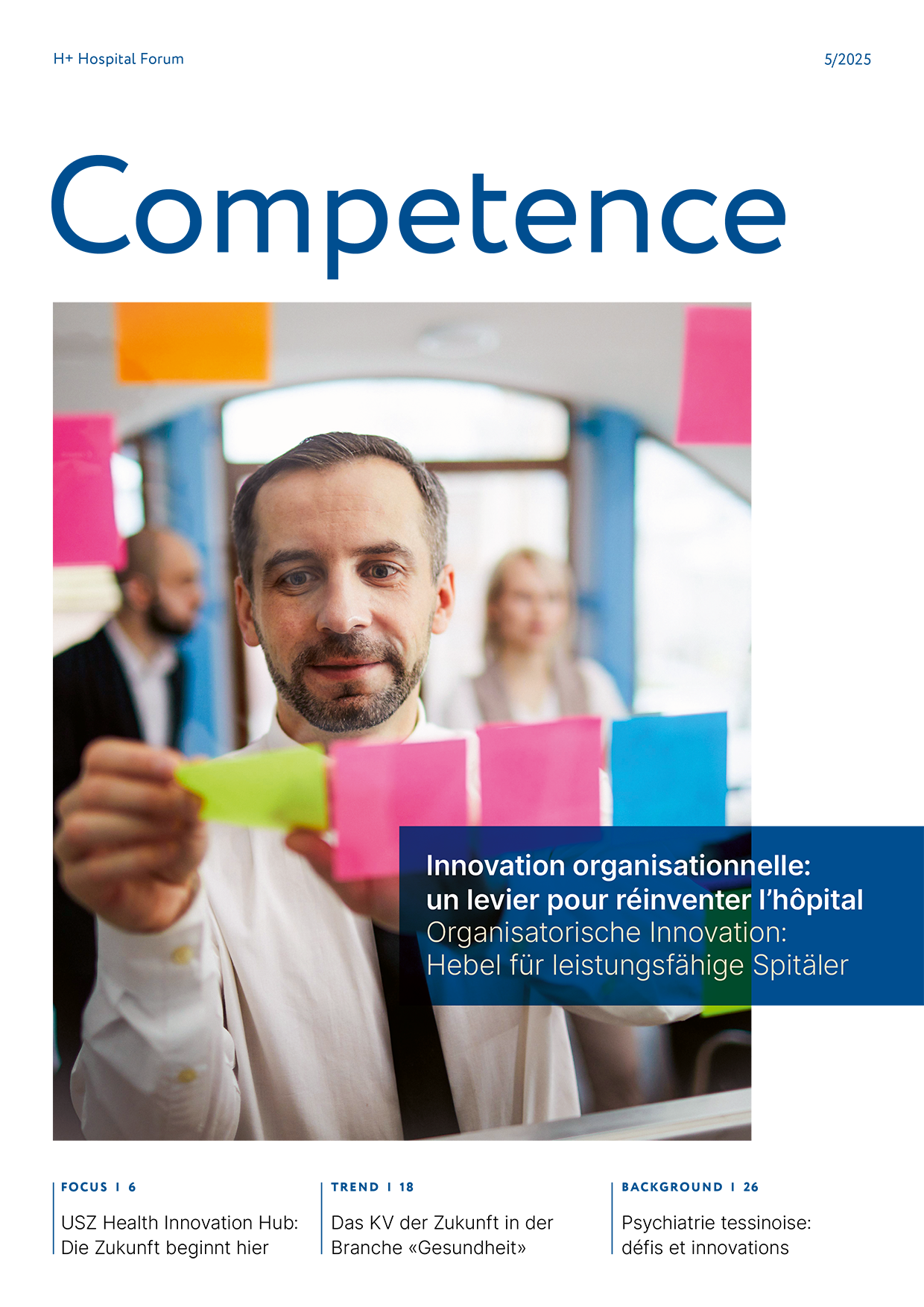7 min
7 minInterview exclusive
Elisabeth Baume-Schneider: «Notre système de santé est excellent, et il a son prix»
Plusieurs cantons doivent intervenir pour sauver les hôpitaux et cliniques déficitaires. Quelles solutions envisagez-vous?
Les hôpitaux et cliniques constituent un pilier majeur de notre système de santé. Bien que la planification hospitalière relève de la compétence des cantons, je suis de très près les informations sur leur situation financière, j’aborde régulièrement ce thème avec les conseillères et conseillers d’Etat responsables de la santé. La Confédération ne saurait se substituer aux cantons dans notre système fédéraliste. Il va sans dire que j’encourage les cantons à aborder la question de la planification hospitalière en regardant au-delà des frontières cantonales, pour trouver les meilleures collaborations possibles au niveau régional.
Selon vous, faut-il moins d’hôpitaux et de cliniques, mais davantage d’établissements spécialisés?
Il ne m’appartient pas de me prononcer sur le nombre d’hôpitaux. Les gouvernements cantonaux sont plus proches des réalités de leur région et des besoins de leur population. La tendance observée depuis plusieurs années vise à renoncer à ce que chaque établissement hospitalier propose toute la palette des prestations. Je pense que cette tendance va encore se renforcer.
Quels sont les avantages du financement uniforme des prestations?
Le financement uniforme de toutes les prestations de santé apporte plusieurs avantages déterminants. Il favorise le passage des soins stationnaires vers les soins ambulatoires à chaque fois que cela fait du sens d’un point de vue médical. Ce qui est dans l’intérêt des patient·e·s et qui contribue à une meilleure maîtrise des coûts.
Cette réforme doit aussi favoriser les soins coordonnés, en assurant que les acteurs de la santé qui s’engagent dans une démarche de coordination soient aussi ceux qui en tirent un bénéfice.
Quelles répercussions un «non» le 24 novembre pourrait-il entraîner?
Un «non» le 24 novembre figerait les incitations négatives dues au système de financement actuel. Un «non» serait aussi un signal d’échec qui conforterait les voix qui affirment qu’aucune réforme n’est possible dans notre système de santé. Je ne partage pas cette approche pessimiste.

Comment la Suisse peut-elle résoudre durablement la pénurie de main-d’œuvre qualifiée?
A l’instar de la situation dans de nombreux domaines de l’économie, j’observe qu’il n’y a pas de recette magique. En ce qui concerne le personnel soignant, nous mettons en œuvre l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée en 2021. Nous avons lancé, avec les cantons, une large offensive de formation depuis le 1er juillet, pour augmenter les effectifs. Et pour encourager les infirmières·ers à ne pas quitter prématurément la profession choisie, nous devons aussi améliorer les conditions de travail, en rendant les horaires plus prévisibles par exemple. Nous avons consulté tous les milieux concernés sur des propositions concrètes.
J’attends des acteurs principaux – dont les hôpitaux – qu’ils apportent leur contribution à la mise en œuvre de l’initiative. L’intérêt pour les professions des soins est grand et conserver l’attractivité de ces métiers est essentiel.
De plus, il est cohérent d’inclure aussi d’autres professionnel·le·s de la santé dans les réflexions, dans la médecine générale ou la pharmacie par exemple. C’est aussi dans ce but que je vais lancer cette année encore un «Agenda soins de base», qui vise à contribuer à renforcer l’approvisionnement en soins de base.
La population vieillit et les progrès médicaux sont rapides. Est-il réaliste d’espérer un ralentissement de la croissance des coûts dans le secteur de la santé?
L’espérer ne suffit pas et il convient de tout mettre en œuvre pour maîtriser la hausse des coûts. Nous avons une série de démarches en cours ou prévues qui y contribuent. L’ensemble des partenaires ont leurs responsabilités à prendre. Par exemple, j’invite le Parlement à donner son aval au deuxième programme visant à freiner la hausse des coûts. Nous avons besoin de mesures telles que des rabais de quantité sur des médicaments à fort chiffre d’affaires. Nous mettons aussi en œuvre le contre-projet à l’initiative de frein aux coûts, qui doit déployer ses effets dès 2026. Il est également nécessaire que les acteurs du système de santé fassent des propositions concrètes. C’est pour en parler et agir que j’invite des représentant·e·s à une table ronde cet automne. Cela dit, je ne vais pas promettre de miracle: notre système de santé est excellent, et il a son prix.
Que répondez-vous à celles et ceux qui se plaignent de devoir consacrer davantage de temps aux tâches administratives qu’aux soins?
J’entends les critiques sur l’excès de bureaucratie et les prends très au sérieux. L’OFSP travaille en ce moment, à ma demande, à une analyse de la situation et à la recherche de solutions. Je suis intéressée à comprendre quelle est la part des tâches administratives générées par des prescriptions légales et quelle part pourrait être évitée en matière d’efficience. Nous avons assurément un retard à combler en matière de digitalisation du système de santé. La digitalisation permet de faciliter le travail des collaborateurs·trices. Et si les données sont compatibles – comme on le vise avec le projet Digisanté ou le Dossier électronique du patient – elles peuvent être échangées avec d’autres prestataires de soins.
Avec DigiSanté, le Parlement a alloué 400 millions de CHF à la numérisation. Comment cela va-t-il concrètement améliorer les soins? Et comment les hôpitaux et cliniques pourront-ils financer la mise en œuvre des projets?
En décidant de débloquer des sommes très conséquentes pour les années 2025 à 2034, le Conseil fédéral et le Parlement ont confirmé que la digitalisation du système de santé est une priorité absolue. Cette décision nécessite également que les différents acteurs de la santé participent à un véritable changement de culture.
Pensez à la standardisation des données: elle est au cœur du programme Digisanté. Le gain d’efficacité sera significatif lorsque les systèmes de tous les partenaires du domaine de la santé pourront communiquer sans obstacle.
On évitera des examens redondants et on pourra renoncer à enregistrer les mêmes données dans plusieurs registres différents. Tout le monde en profitera, et les patient·e·s naturellement aussi. Mais pour permettre cette avancée, il faut accepter les mêmes standards et faire les investissements nécessaires.
Quels sont vos objectifs à long terme pour le système de santé suisse?
Qu’il conserve son excellente qualité, bien-sûr, tout en restant finançable. La sécurité des patient·e·s doit rester au centre de notre système santé. La confiance est également importante et l’accès aux soins de base est un objectif qui me tient à cœur. Le système de santé doit par ailleurs offrir de bonnes conditions de travail. Plus généralement, je souhaite que toutes les questions sensibles en politique de la santé – et elles sont nombreuses – fassent l’objet de débats sereins et constructifs. Nous avons besoin de compromis acceptables par tout le monde pour pouvoir avancer dans une relation de confiance et mettre en place les réformes dont notre système de santé a besoin. Le financement uniforme des prestations de santé, sur lequel nous votons le 24 novembre, en est un bon exemple.
Photo de titre: Chancellerie fédérale/Béatrice Devènes