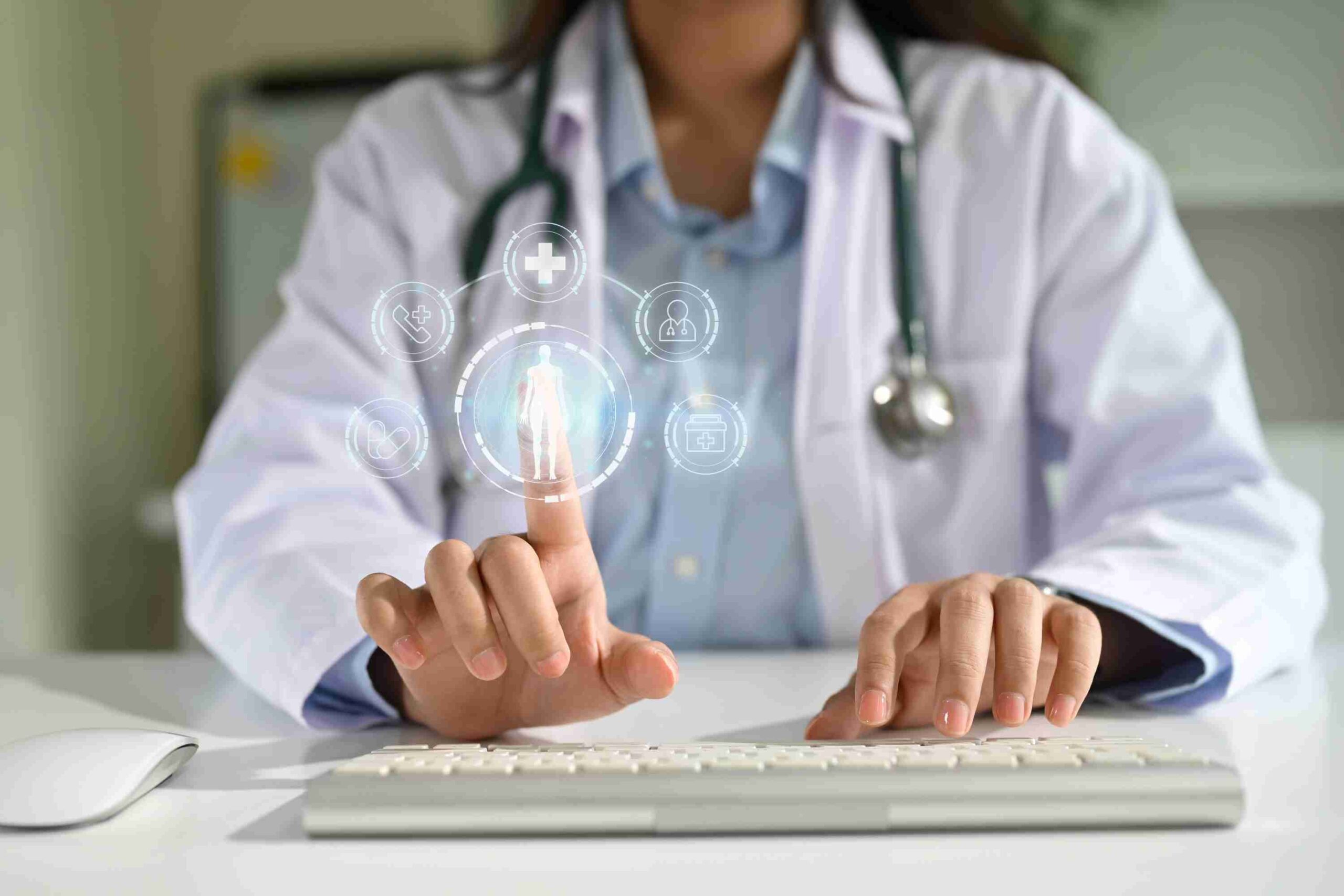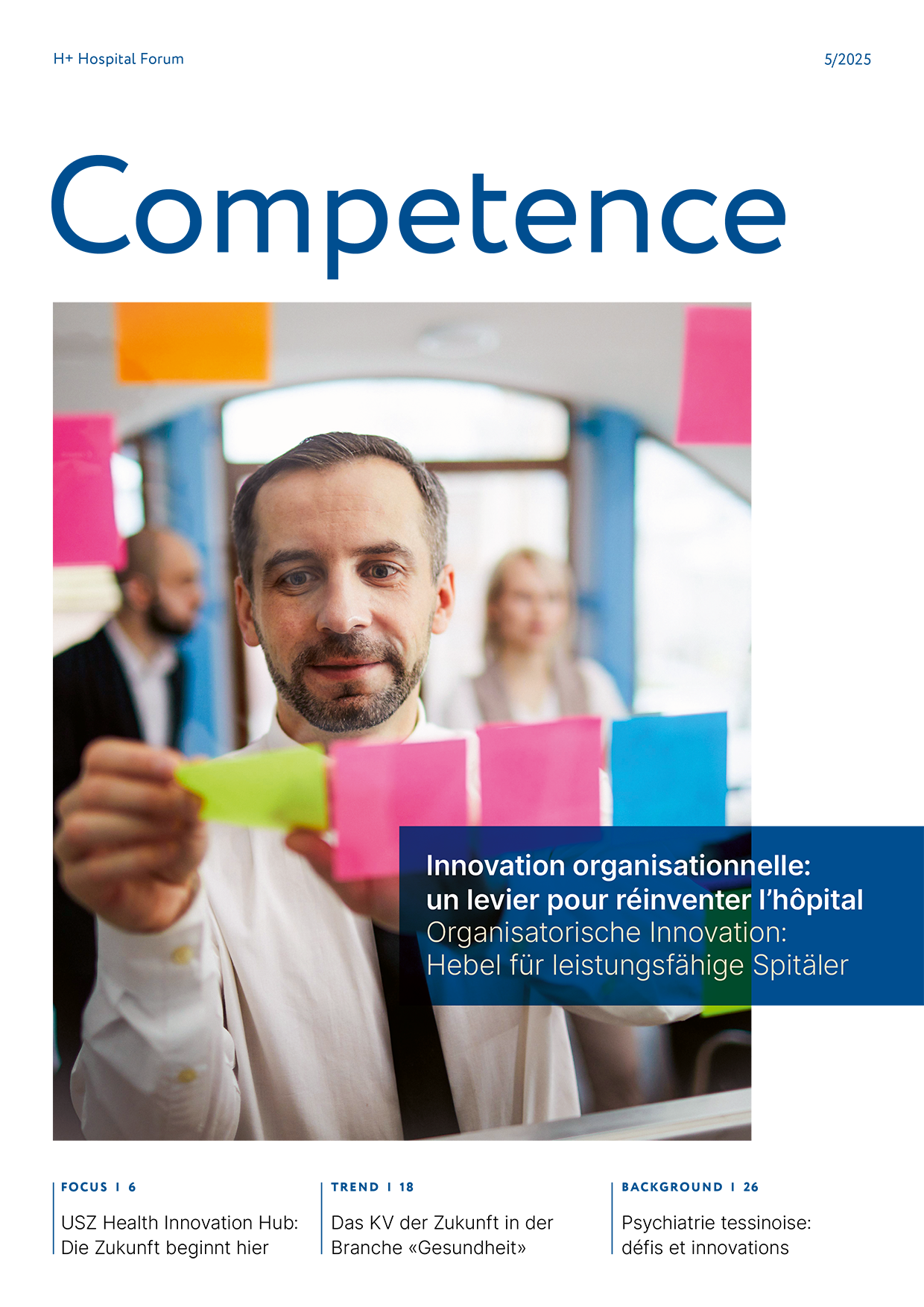4 min
4 minSortir de la crise?
À chaque vallée son hôpital: une époque révolue
Les hôpitaux sont des lieux chargés d’émotions, où se déroulent des événements existentiels. Cela explique l’intérêt qu’ils suscitent – y compris sur le plan financier. Lorsque l’on cherche des raisons à l’augmentation des primes d’assurance-maladie, les hôpitaux sont fréquemment pointés du doigt, souvent accompagnés de l’expression «À chaque vallée son hôpital».
Pourtant, cette vision ignore qu’en 2002, la Suisse comptait 363 hôpitaux, contre seulement 278 aujourd’hui.
Elle passe également sous silence le fait que les coûts des prestations hospitalières stationnaires évoluent de manière relativement modérée. Il y a dix ans, le secteur hospitalier stationnaire représentait un quart des dépenses brutes de l’assurance-maladie obligatoire; aujourd’hui, il en représente moins d’un cinquième.
Cela ne diminue en rien l’importance cruciale du secteur hospitalier. La pandémie de COVID-19 a montré la valeur d’un réseau hospitalier capable de gérer des pics d’occupation. Ceux qui affirment qu’il serait facile de fermer la moitié des hôpitaux font preuve d’un optimisme irréaliste et oublient que l’offre hospitalière doit également fonctionner en temps de crise ou de catastrophe. Plus que le nombre d’établissements, les questions essentielles sont: qui fait quoi? Quelles prestations doivent être stationnaires et lesquelles peuvent être ambulatoires? Et selon quels critères médicaux?
Ambulatoire: le rôle accru des cantons
Le paysage hospitalier continue d’évoluer. En 2026, la structure tarifaire obsolète TARMED sera remplacée, ce qui pourrait accélérer le transfert des soins stationnaires vers le secteur ambulatoire. De plus, grâce au vote populaire en faveur du financement uniforme, d’autres obstacles seront levés. Les cantons joueront un rôle accru dans le financement des prestations ambulatoires, un secteur souvent non rentable pour les hôpitaux, contribuant ainsi à leurs problèmes financiers actuels.
Avec la nouvelle structure tarifaire ambulatoire et le financement uniforme, des jalons importants sont posés dans la bonne direction.
En parallèle, le Parlement fédéral remet en question l’actuelle répartition des compétences. Certains proposent d’accorder un rôle accru à la Confédération dans la planification hospitalière, voire de centraliser cette compétence. Pourtant, la planification hospitalière est entre de bonnes mains au niveau des cantons. Elle nécessite une acceptation locale, une intégration dans le système de santé régional et une légitimité démocratique par les populations concernées. La Confédération, éloignée des réalités locales, n’est pas mieux placée pour assumer cette tâche.

Coopération intercantonale à renforcer
La question des compétences en matière de planification hospitalière a également une dimension financière. Aujourd’hui, les cantons supportent au moins 55% des coûts des prestations hospitalières stationnaires, soit environ 9 milliards de francs en 2022. Si la compétence de planification devait être transférée à la Confédération, celle-ci devrait logiquement prendre en charge le financement.
Cependant, il est compréhensible de demander une coopération intercantonale plus étroite et systématique dans la planification hospitalière. De bons exemples existent déjà, comme des listes hospitalières harmonisées entre cantons.
En novembre 2024,l’assemblée plénière de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a décidé de renforcer ses recommandations sur la coordination et la collaboration intercantonale en matière de planification hospitalière.
La coopération entre cantons est également démontrée dans le domaine de la médecine hautement spécialisée (MHS), où une planification commune a été établie depuis 2009, permettant une coordination nationale dans plusieurs domaines. Toutefois, certains parlementaires souhaitent redonner plus d’autonomie aux cantons dans ce domaine.
Attentes divergentes
Les cantons font face à des exigences contradictoires: d’une part, ils doivent planifier le paysage hospitalier à l’échelle nationale dans certains domaines, et d’autre part, on leur demande davantage d’autonomie ou même de transférer certaines compétences à la Confédération.
Des contraintes juridiques qui compliquent
Le cadre juridique de la LAMal ajoute à ces tensions. Les cantons sont censés éviter les surcapacités et limiter l’augmentation des coûts via leur planification hospitalière. Pourtant, la libre hospitalisation des assuré·e·s et le système des hôpitaux conventionnés affaiblissent ces efforts, tout comme les droits de recours des hôpitaux exclus des mandats de prestations. Ces points devraient être révisés en priorité plutôt que de proposer des solutions simplistes comme la centralisation.
Ce qui est certain: les cantons continueront à participer de manière constructive aux débats, en veillant à défendre les intérêts de leurs populations respectives et en s’efforçant de trouver des solutions équilibrées pour toutes et tous.
Ils garderont pour priorité de garantir une prise en charge de qualité, accessible à tous·toutes les patient·e·s, tout en tenant compte des contraintes financières et des évolutions du système de santé.
Photo de titre: via Canva.com