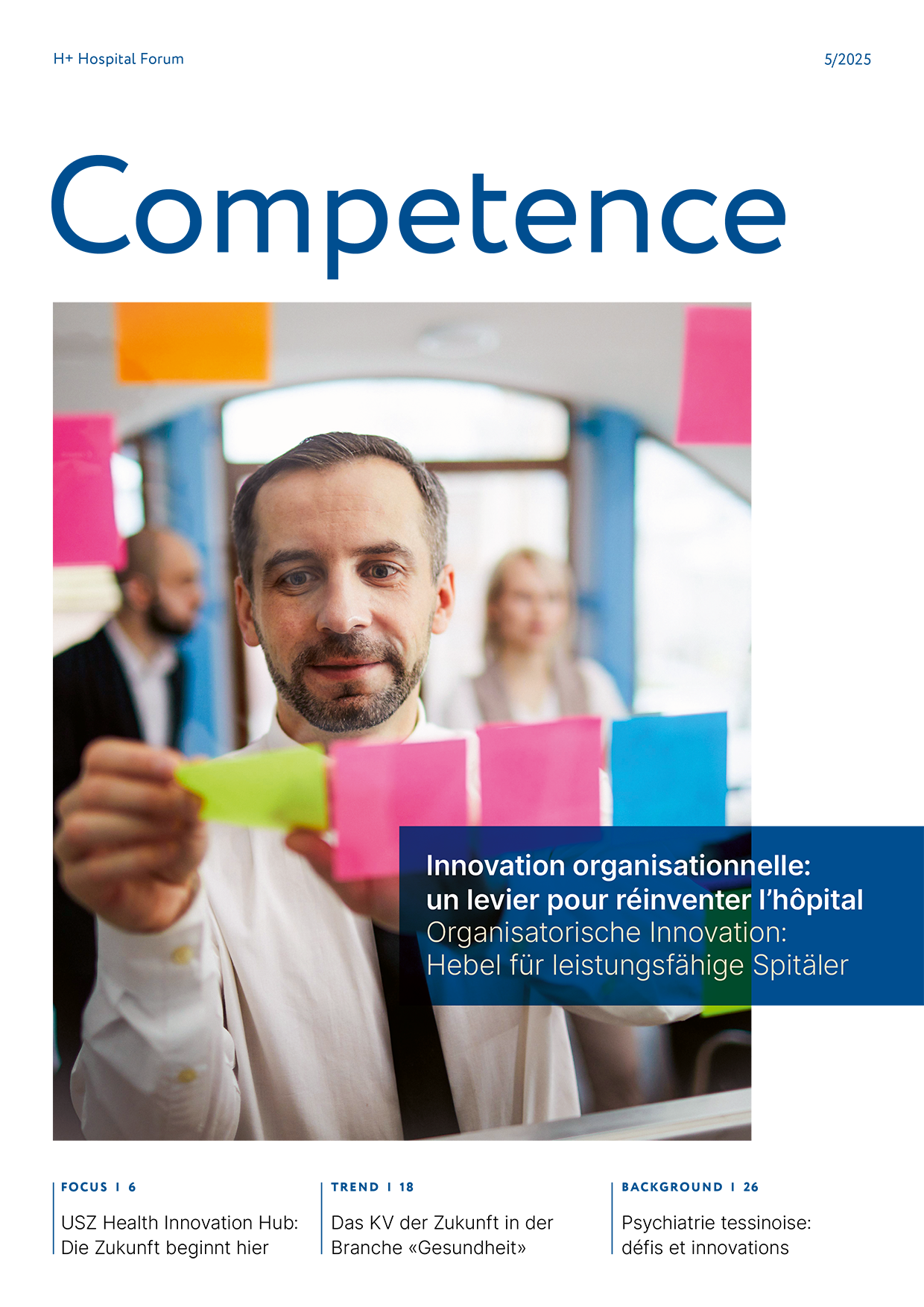5 min
5 minItinéraires cliniques et soins intégrés
Entre promesses et obstacles financiers
À quoi servent les itinéraires cliniques?
Ils sont là pour standardiser et optimiser le parcours et la prise en charge des patient·e·s: grâce à ces derniers, les professionnel·le·s de la santé sont certain·e·s de ne pas manquer la moindre étape, d’effectuer chaque examen, chaque radio, dans les bonnes temporalités. Chaque étape du suivi médical est détaillée et formalisée, ce qui fonctionne très bien dans des prises en charges telles que les cancers, les accidents cardio-vasculaires, les prothèses de hanche, pour ne citer que quelques exemples.
Cela permet d’améliorer la coordination entre les interventions des profesionnel·le·s de la santé et entre les unités/services et in fine d’assurer une bonne qualité des soins.
Cela a-t-il un impact sur la qualité?
Oui, car on standardise la prise en charge et on met en place tout ce qui est recommandé pour une pathologie donnée, notamment dans les recommandations de la pratique clinique. On veille ainsi à n’oublier aucun aspect de la prise en charge. Tandis que des bénéfices cliniques, de santé, sont décrits, les éventuelles répercussions financières restent difficiles à évaluer. Puisque tout est standardisé et planifié dès le départ, contrairement à une prise en charge similaire mais sans itinéraire clinique, on fait l’hypothèse que l’utilisation d’itinéraires cliniques a un impact sur les coûts.

Quel est le lien entre soins intégrés et itinéraires cliniques?
Si l’on prend un réseau régional de soins intégrés, avec une approche populationnelle, c’est-à-dire ciblant toute la population d’une région et pas seulement les patient·e·s ayant recours aux services de santé, il pourrait être très intéressant de développer des itinéraires de prise en charge qui soient plus globaux et qui ne se concentrent pas uniquement sur le séjour hospitalier. On sait effectivement que la très grande majorité des prises en charge se font hors des hôpitaux. Chaque prestataire et/ou institution de soins serait impliqué, ce qui permettrait de lier davantage les différent·e·s intervenant·e·s, d’améliorer la coordination et la continuité de la prise en charge où qu’elle ait lieu.
Faudrait-il revoir le modèle de financement?
Je pense qu’il est nécessaire d’être innovant en termes de modalités de financement, afin de ne pas entraver le développement de nouvelles initiatives. En Suisse, il n’y a pas forcément d’incitatifs pour développer ce type de projets, qui nécessitent un certain investissement pour qu’ils voient le jour. Il faut trouver un moyen de mieux valoriser, financer et facturer certaines prestations, comme la coordination par exemple ou des prestations cliniques effectuées par des professionnel·le·s de la santé autres que les médecins. Des financements globaux, englobant les différent·e·s intervenant·e·s et prestations sur l’ensemble d’un parcours, ou alors par personne par année, sont à privilégier.
Quel rôle les hôpitaux ont-ils à jouer au niveau des soins intégrés?
«Je pense que les établissements hospitaliers, régionaux notamment, pourraient jouer un rôle important dans le cadre du développement des soins intégrés en Suisse; on le voit avec les différentes initiatives qui se développent actuellement, collaborativement entre des structures de soins et des assurances maladie, voire des cantons, note la professeure Isabelle Peytremann-Bridevaux. Les établissements hospitaliers font partie intégrante des services de santé et représentent ainsi des acteurs clés du terrain, plus ou moins proches de la communauté selon les contextes. Cela représente un atout pour piloter de tels projets régionaux de soins intégrés.»
Pour quelles raisons l’impact des soins intégrés est-il difficile à mesurer au niveau financier?
Il est compliqué de savoir ce qu’il faut considérer ou non dans les coûts des analyses économiques, et de quelle manière monétariser certains aspects de la prise en charge, comme le fait de limiter les hospitalisations, retourner plus rapidement à la maison voire à son travail, ou l’apport des proches aidant·e·s. On s’en tient le plus souvent à considérer ce qui est facturé aux assurances, ce qui ne représente de loin pas toutes les charges. Considérer une perspective sociétale est compliqué, d’autant plus que nous manquons cruellement de données de bonne qualité. Une autre problématique est que souvent, des projets sont mis en œuvre sans forcément penser à leur évaluation ou les ressources manquent pour ce faire. Enfin, il est nécessaire de réaliser que les répercussions de ces nouveaux modèles se font plus sur le long que le court terme, tant en regard de la santé que de coûts.
Les soins intégrés peuvent-ils réduire les coûts de la santé?
Les soins intégrés ne sont pas la solution magique à l’augmentation continuelle des coûts de la santé. Il est très peu probable qu’ils arrivent à eux seuls à diminuer les coûts. Il me semble utopique d’envisager le contraire alors que la population vieillit, que les besoins en santé et en soins continueront d’augmenter dans le futur et que tous les prix augmentent. Mais ils peuvent effectivement contribuer à limiter cette augmentation, ainsi qu’à améliorer la qualité des soins.
Les soins intégrés vont-ils sauver le système de santé suisse?
Je ne le pense pas. Ils font par contre partie des structures qu’il faut continuer de soutenir, de développer, d’analyser et de sérieusement considérer, que ce soit pour le bien-être de la population générale et des patient·e·s, mais aussi pour celui des professionnel·le·s de la santé.
Les soins intégrés permettent en effet souvent à ces derniers·ères de faire valoir d’autres compétences, d’envisager de nouveaux rôles et de peut-être trouver davantage de sens dans leur travail.
Je pense aux Maisons de santé qui se développent à Genève et ailleurs, par exemple. Les retours semblent révéler que le personnel connaitrait moins de tournus, reporterait une meilleure satisfaction au travail. Tous les acteurs·trices s’entendent pour dire qu’il est nécessaire de faire bouger les choses. Un incitatif fort manque encore. Je pense que la Suisse reste un pays possédant beaucoup de ressources, comparativement à d’autres pays: lorsque certaines choses ne pourront vraiment plus être financées, la Suisse sera forcée de trouver des solutions innovantes pour son système de santé.
Photo de titre: via Canva.com