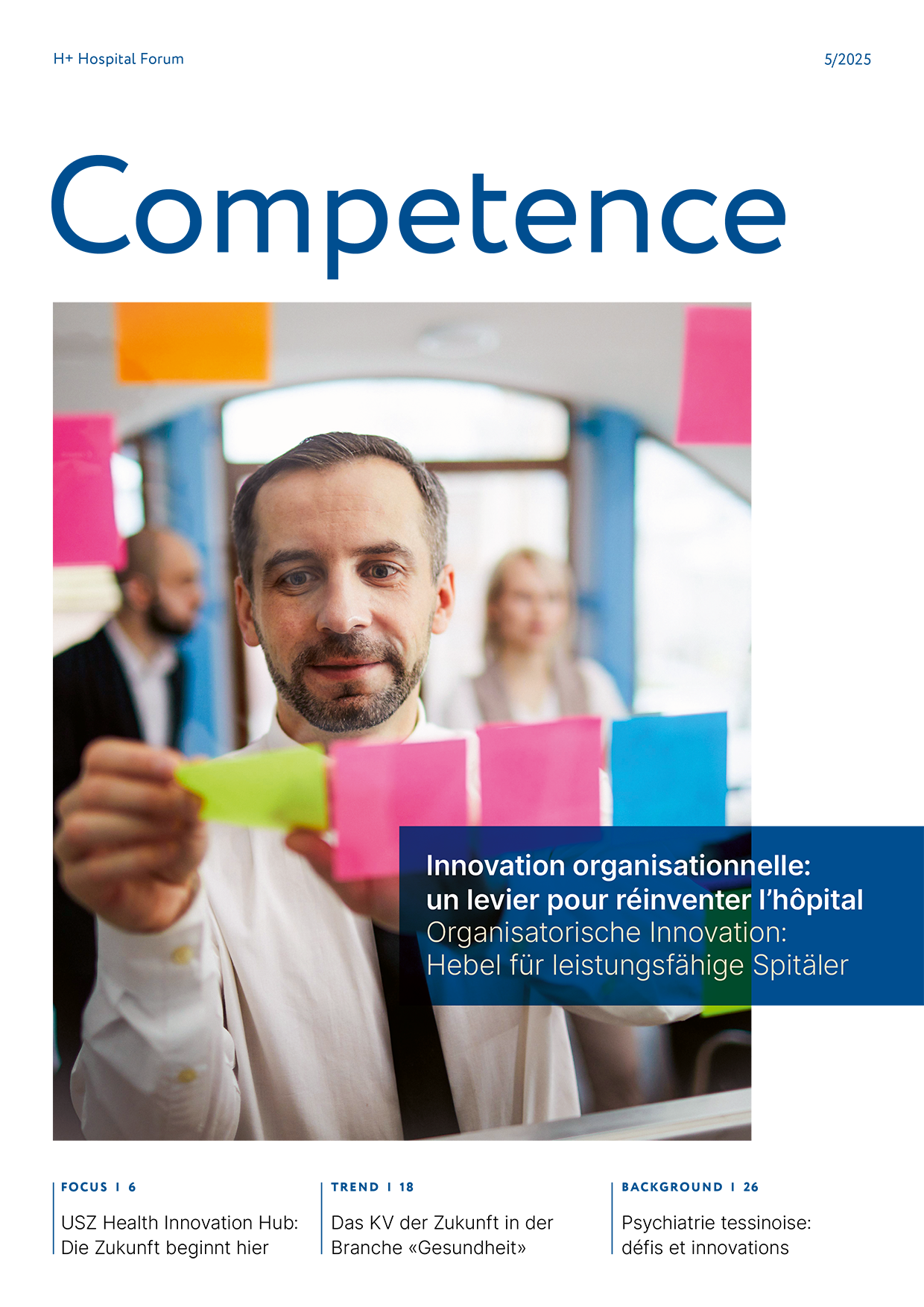5 min
5 minVie académique
Coproduction: Unisanté ouvre une chaire unique en Suisse
De quelle manière l’idée de créer cette chaire, inédite dans le paysage académique suisse, a-t-elle émergé?
Marie-Anne Durand: La thématique autour de la co-production, de la décision médicale partagée est très investie par Unisanté depuis une quinzaine d’année. Nous avons souhaité consolider encore davantage cette dynamique en proposant un enseignement autour de la décision médicale partagée dans l’école de médecine. Très récemment, nous avons intégré des patient∙e∙s simulé∙e∙s, ce qui aide les étudiant∙e∙s à promouvoir la décision médicale partagée dans les consultations. Nous avons également développé les partenariats patient∙e/citoyen∙ne/chercheur∙euse. Le timing était donc idéal pour mettre cette nouvelle chaire en place.
Pendant leur cursus, les futur∙e∙s médecins vont forcément passer par cette dernière?
Oui, à l’Unil, tous∙tes suivront cet enseignement durant deux années consécutives dans leur cursus, en quatrième et cinquième années. Une partie sera davantage tournée vers la théorie. Celle-ci sera suivi par un enseignement plus approfondi de deux heures, avec l’intervention de patient∙e∙s simulé∙e∙s, où trois scénarios cliniques différents seront analysés.
Pensez-vous qu’à l’heure actuelle, la voix des patient∙e∙s n’est pas assez prise en compte?
Je ne sais pas si l’on peut dire cela. On assiste à une révolution du mode de communication: les gens ont de plus en plus accès à l’information. La∙le patient∙e vient en étant de plus en plus informé∙e, avec peut-être davantage de besoins de dire ce qui pour elle ou lui semble la bonne option de traitement.
Notre but est de donner les outils aux étudiant∙e∙s pour que cela puisse devenir routinier, que cet échange puisse avoir lieu dans chaque consultation pertinente.
Justement, comment sélectionnez-vous les consultations pertinentes?
Il s’agit des situations d’équilibre clinique où deux options ou plus sont envisagées, où une solution n’est pas considérée comme supérieure cliniquement. Par exemple, pour le traitement d’une arthrose du genou, on a le choix d’essayer des traitements plus conservateurs (anti-douleurs, perte de poids, exercice physique, physiothérapie, etc.) ou de se tourner vers la chirurgie (remplacement de l’articulation par une prothèse). Chaque option a des avantages et des inconvénients, la∙le médecin seul∙e n’est pas en mesure de décider, car chaque option se vaut. Il est ainsi préférable alors d’impliquer la∙le patient∙e et ses proches dans un processus de prise de décision médicale partagée.
Les futur∙e∙s médecins apprennent ainsi à adapter leur vocabulaire?
Oui, tout à fait. On leur apprend à avoir un langage plus simple, à éviter au maximum les termes médicaux complexes, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. On leur donne des principes à suivre pour avoir une communication qui soit la plus claire possible.
Nous les encourageons également à utiliser le silence comme outil: elles et ils sont invité∙e∙s à compter dans leur tête jusqu’à cinq ou dix pour laisser le temps et la place à l’interlocuteur∙trice de poser des questions.
On se rend compte que lorsque l’on s’arrête de parler, les gens posent davantage de questions.
Êtes-vous optimiste pour l’avenir des coproductions en santé?
Complètement. De plus en plus de personnes s’intéressent à ces thématiques. Beaucoup d’initiatives voient le jour pour mettre en relation les patient∙e∙s, les citoyen∙ne∙s, les médecins pour favoriser les partenariats dans les soins et la recherche. C’est une solution d’avenir qui fait partie des priorités.
Quel est le but ultime de ces partenariats?
Améliorer la qualité des soins. On se rend compte que déjà rien qu’au niveau de la recherche, quand les patient∙e∙s sont impliqué∙e∙s dans les projets, le recrutement augmente, la rétention également, de même que la satisfaction. De plus, les résultats sont davantage applicables et généralisables, car les interventions ont été développées avec les personnes directement concernées.
Assistons-nous à un changement de paradigme?
Oui, tout à fait. Au niveau de la décision médicale partagée, cette tendance se dessine depuis une trentaine d’années déjà: énormément de médecins promeuvent cette approche-là. Les patient∙e∙s sont plus engagé∙e∙s, si elles et ils ont bien compris les bénéfices des traitements, il y a bien plus de chances qu’elles et ils les suivent, et donc que les résultats thérapeutiques soient bien meilleurs.
Lorsque la communication est bonne, les patient∙e∙s sont davantage satisfait∙e∙s, les interactions et les relations médecins-patient∙e∙s sont plus positives. Tout le monde y gagne!
Cette philosophie a-t-elle également un impact sur les coûts de la santé?
Des études ont été menées au niveau international: il semblerait que oui, notamment lorsque l’on s’intéresse à des situations cliniques présentant plusieurs options. Des économies sont alors réalisées au niveau du système de santé, les options plus invasives étant souvent réalisées dans un second temps uniquement.
Quels conseils donneriez-vous à un établissement qui souhaiterait favoriser ces partenariats?
D’essayer de le faire progressivement; les changements de culture ne se font pas du jour au lendemain. Je conseillerais également de commencer par exemple par faire relire les documents d’information et les pages de sites internet à des patient∙e∙s, des citoyen∙ne∙s. Souvent, il y a beaucoup de choses que l’on ne remarque pas…
Photo de titre: Prof. Marie-Anne Durand (crédit: Unisanté)