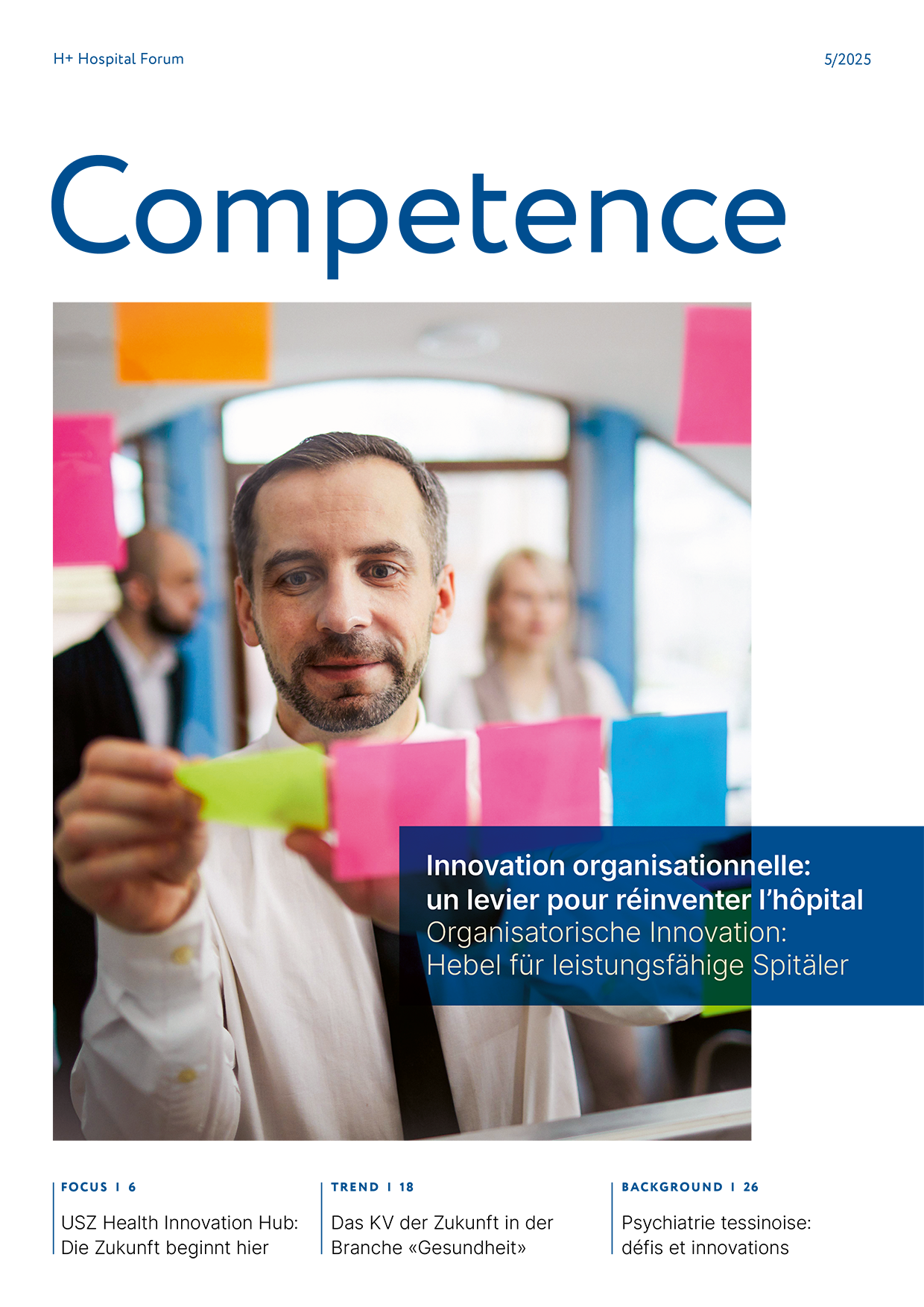4 min
4 minUniversité de Genève (UNIGE)
Cancer du côlon: les lipides peuvent prédire l’efficacité des traitements
Chaque année, près de 2 millions de nouveaux cas de cancer du côlon sont diagnostiqués dans le monde. D’ici à 2040, ce chiffre pourrait dépasser les 3 millions, portant le nombre de décès à 1,6 million contre 700’000 actuellement. Ce mauvais pronostic s’explique par un diagnostic souvent tardif, la maladie restant longtemps asymptomatique.
Son traitement, à un stade avancé, repose essentiellement sur une combinaison de chimiothérapies appelée FOLFOXIRI. Ce protocole entraîne d’importants effets secondaires et son efficacité varie considérablement d’un individu à l’autre. Mais, surtout, les cellules tumorales y deviennent progressivement insensibles pour finalement développer une résistance. Parvenir à contrer ce phénomène constitue l’un des grands défis actuels de la recherche en oncologie.
Une «signature lipidique»
L’équipe de Patrycja Nowak-Sliwinska, professeure associée à la Section des sciences pharmaceutiques de la Faculté des sciences de l’UNIGE, a mené plusieurs travaux sur cette problématique. Après avoir mis au point une combinaison de médicaments (2022) potentiellement capable de contourner cette résistance, puis des tumeurs artificielles pour tester l’efficacité des traitements (2023), elle révèle aujourd’hui que les cellules cancéreuses devenues résistantes au FOLFOXIRI présentent des altérations spécifiques au niveau de certains lipides.
«L’identification des espèces de lipides modifiées pourra servir de marqueur pronostique potentiel pour la résistance à la chimiothérapie. En outre, comprendre ces changements peut participer au développement de nouvelles stratégies de traitements pour surmonter cette résistance et pourrait jouer un rôle crucial dans la restauration de la sensibilité aux médicaments», explique Dr. George M. Ramzy, membre de l’équipe de Patrycja Nowak Sliwinska, maître-assistant à la Section des sciences pharmaceutiques de la Faculté des sciences de l’UNIGE, premier auteur de l’étude.
Pour parvenir à ces résultats prometteurs, l’équipe de Patrycja Nowak-Sliwinska a collaboré avec celle de Serge Rudaz, professeur ordinaire à la Section des sciences pharmaceutiques. Quatre lignées de cellules cancéreuses provenant de quatre patients ont été étudiées, chacune présentant un profil génétique distinct.
En laboratoire, une partie de ces cellules a été exposée au FOLFOXIRI durant 60 semaines, le temps nécessaire pour induire une résistance au traitement, comme observé en contexte clinique. Une autre partie de l’échantillon n’a pas été traitée. «Nous avons alors analysé et comparé le profil lipidique, ou ‘‘lipidome’’, des cellules cancéreuses ayant acquis une résistance à celui des cellules qui n’ont reçu aucun traitement», détaille Prof. Patrycja Nowak-Sliwinska, qui a dirigé ces travaux.
Grâce à un algorithme «maison»
«Un profilage lipidique non ciblé a été réalisé en utilisant la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution pour distinguer les différentes sous-espèces lipidiques», indique Dr. Isabel Meister, maître-assistante à la Section des sciences pharmaceutiques de la Faculté des sciences de l’UNIGE, et co-autrice de l’étude.
Afin d’analyser les données et interpréter les différentes altérations lipidiques, l’équipe a utilisé un algorithme spécialement conçu pour distinguer les variations communes et spécifiques entre le lipidome des cellules sensibles et celui des cellules résistantes au FOLFOXIRI.
«La grande dimensionnalité des données et les différentes sources de variabilité des signatures lipidomiques ont pu être traitées de manière adaptée à l’aide d’une approche qui associe le plan expérimental et l’analyse des différents facteurs impliqués, comme le profil génétique et la résistance au traitement», explique Dr. Julien Boccard, chargé d’enseignement à la Section des sciences pharmaceutiques de la Faculté des sciences de l’UNIGE.
Des variations d’un individu à l’autre
Cette méthode a permis de démontrer, dans une première lignée cellulaire, que la résistance était liée à une augmentation des triglycérides et des esters de cholestérol. Dans les trois autres lignées, à une augmentation des phospholipides. «Ces différences s’expliquent par les profils génétiques distincts de chaque individu. Chaque patient est différent. C’est ce qui explique la variabilité de l’efficacité des traitements», indique George M. Ramzy.
Si ces résultats ouvrent la voie à des stratégies de traitements personnalisés ou à la restauration de la sensibilité à la chimiothérapie, ils ne sont pas encore applicables cliniquement.
Avant de franchir cette étape, ils devront être testés directement sur des échantillons de tumeurs fraîchement prélevées chez des patients, et non sur des lignées de cellules tumorales conservées en laboratoire.
Photo de titre: Image d’illustration générée par intelligence artificielle représentant l’exposition chronique au FOLFOXIRI (gauche), qui induit des altérations lipidomiques significatives dans les cellules cancéreuses colorectales (droite). Crédit: George M. Ramzy – UNIGE