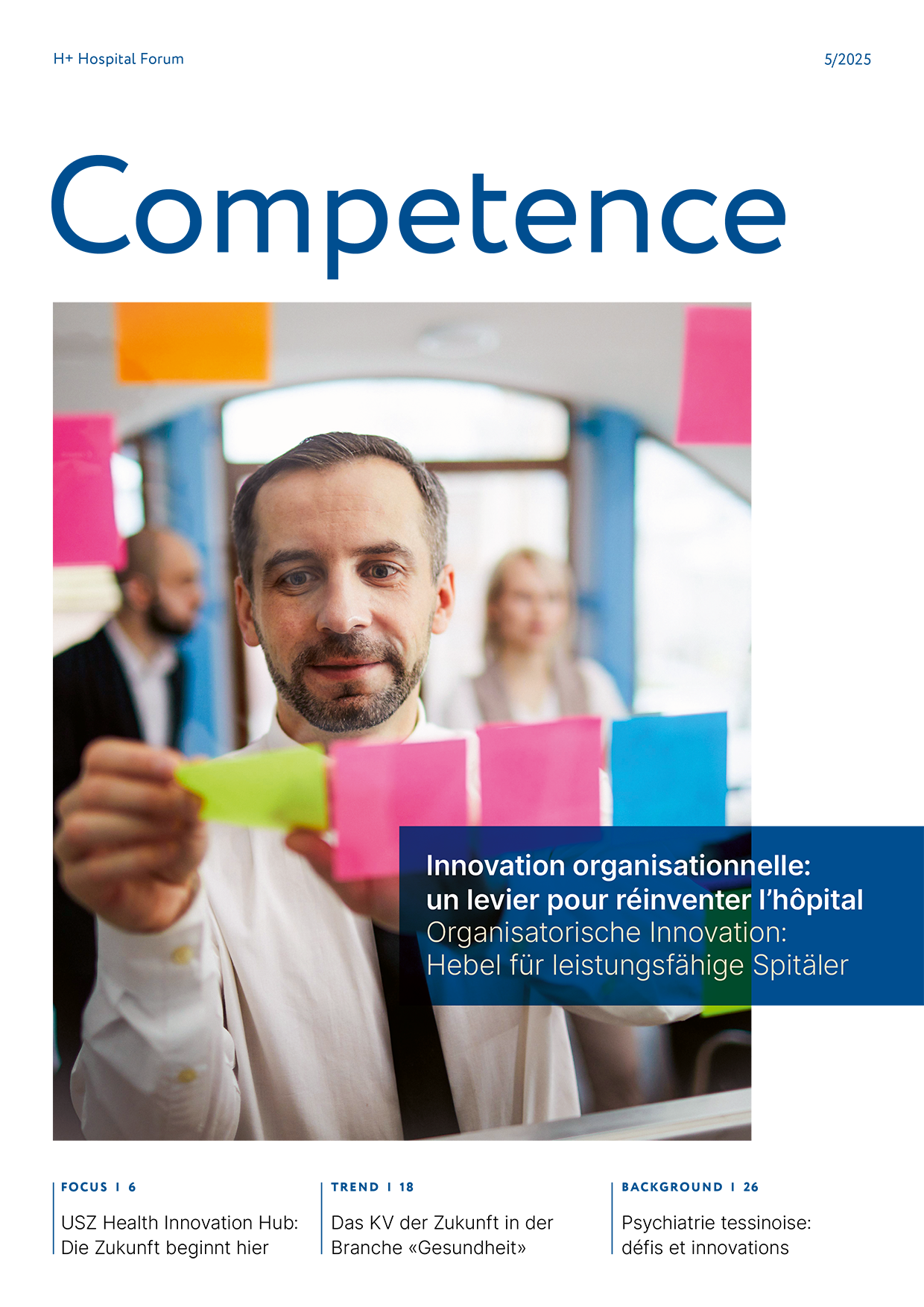9 min
9 minCommission technique H+
La formation au cœur de l’hôpital de demain: quelles stratégies adopter?
En tant que membre de la Commission technique de H+ et spécialiste des questions de formation professionnelle, comment décrivez-vous l’état actuel de la formation dans le secteur hospitalier en Suisse?
Des efforts incessants, aussi bien en termes financiers qu’en gestion des ressources humaines, sont fournis au quotidien par le secteur hospitalier pour former son personnel. Le but est double: d’une part, garantir, par le développement des compétences, la qualité et la sécurité des soins ainsi que l’excellence clinique et, d’autre part, favoriser la rétention du personnel, principalement soignant.

Quelles sont les thématiques qui doivent absolument être abordées par la Commission?
La commission technique «Formation» de H+ est jeune; nous ne nous sommes rencontrés qu’à deux reprises. Elle a pour mission de travailler sur les deux pans de la formation, initiale et continue, pour l’ensemble des acteurs et actrices des soins. On parle aussi bien des médecins que des infirmières∙ers, des professionnel∙le∙s des secteurs médico-thérapeutique et médico-techniques, et également des assistant∙e∙s en soins et santé communautaire et du personnel d’assistance.
De mon point de vue, nous devons réfléchir la manière dont le système de formation Suisse promeut le passage de la formation primaire à secondaire et tertiaire en intégrant, dans les plans d’études, les compétences transversales aux différents acteurs et actrices de la santé.
Ceci signifie que ces compétences doivent être développées et reconnues dans l’ensemble des secteurs de formation. Aujourd’hui, les formations initiales sont encore trop sectorialisées (médecins – soignant∙e∙s) Je pose souvent la question: puisque nous travaillons ensemble, pourquoi ne nous formons-nous pas ensemble ?
Pouvez-vous précisez les enjeux et objectifs poursuivis?
Pour la formation initiale, la commission réfléchit à la capacité du système à former des professionnel∙le∙s de santé travaillant ensemble, de manière interdisciplinaire et interprofessionnelle pour une prise en soins optimale.
En ce qui concerne la formation continue, l’enjeu est économique et demande de trouver comment mutualiser et rationnaliser les soutiens et incitatifs financiers à la formation. Souvent le prix d’une formation n’est pas lié à la qualité des prestations de formation mais à l’évolution du marché de la formation en Suisse et à l’étranger. Si les soignant∙e∙s sont parfois frileux∙euses à aborder le sujet financier, la commission technique «Formation» ne l’est pas et l’intègre pleinement dans ses réflexions.
Un autre objectif est plus «sociologique» et lié au capital humain et à l’organisation du travail. Comment libérer les professionnel∙le∙s pour leur permettre de suivre leurs formations continues dans un secteur qui est marqué par la pénurie de personnel, un fort turn-over, et où des personnes qui se disent épuisées quittent leur profession après quelques années de pratique? Lorsqu’un∙e professionnel∙le est en formation, il ou elle n’est évidemment pas en activité clinique et il faut le remplacer. On ne ferme pas un service pour que nos collaborateurs∙trices puissent se former et l’excellence des prestations cliniques doit être assurée.
L’énigme à résoudre est: comment garantir une formation continue de qualité qui réponde à des besoins réels en interprofessionnalité tout en gardant le personnel en activité?
Avez-vous une piste pour résoudre cette énigme?
Les sciences de l’éducation nous permettent, théoriquement, de résoudre, en partie, cette énigme, en visant principalement des formations de type «on the job learning». Former par et dans l’activité réelle assure le développement de compétences dites situées (qui répondent à la spécificité du milieu) et permet de trouver du sens au travail. La perte de sens est un des facteurs de démobilisation du personnel soignant.
J’ajouterai que la réflexion sur l’intégration des outils numériques comme support à la formation est aussi en cours pour répondre à ce défi. Il y a ici la possibilité de former à distance, en asynchrone et permettre de briser partiellement les obstacles du temps et du lieu. Néanmoins, cela demande un investissement important pour les personnes qui se forment.

La Commission technique Formation de H+ est une instance interprofessionnelle. En quoi cette dimension est-elle un atout pour la réflexion et la mise en place de stratégies de formation adaptées aux besoins du secteur hospitalier?
C’est plus qu’un atout, c’est primordial et une condition sine qua non à la prise en soins globale du∙de la patient∙e. L’hyperspécialisation nous a fait perdre de vue l’approche holistique de l’humain incluant son environnement de vie. Aujourd’hui, nous nous rendons compte que cela représente un problème et la volonté est d’intégrer la∙le patient∙e comme partenaire.
Bien que tous les soignant∙e∙s travaillent tous les jours ensemble, nous constatons qu’elles∙ils ne se connaissent pas si bien que cela. Lors de nos travaux dans la commission technique, des questions émergent, comme par exemple, celle sur le rôle et les fonctions des soignant∙e∙s qui obtiennent des masters (IPS, ICLS, Master Santé).
Ces formations ont été développées à la suite du niveau de formation Bachelor. Elles font sens pour les soignant∙e∙s qui peuvent ainsi accéder à plus de responsabilités et développer la pleine étendue de leurs compétences, mais elles sont un peu moins évidentes pour les médecins. Cette situation est typique d’un développement d’une profession sans y inclure les autres professions. Lors de nos travaux en commission, nous partageons les différentes approches avec nos collègues d’autres disciplines. Si nous pouvons le faire en commission, il est aussi possible de le faire sur le terrain et cela probablement à tous les niveaux.
Avez-vous des exemples concrets où cette approche interprofessionnelle a permis d’apporter des solutions innovantes ou d’améliorer la formation dans les hôpitaux suisses?
L’exemple le plus emblématique est celui de la formation par simulation. Cette approche est basée sur la scénarisation de situations critiques avec un haut risque d’erreurs qui impliquent des complications graves. Il s’agit de cas de survenue rare, extrêmement stressants, qui mobilisent plusieurs disciplines et différents types de professionnel∙le∙s. Travailler ces situations permet d’être prêt∙e lorsque celles-ci se présentent. Cela permet également aux différentes professions de santé de mener une réflexion commune sur les situations complexes lors des moments de briefing et feedback qui sont essentiels à l’apprentissage. La formation par simulation est très efficace mais coûteuse en temps et en argent (patient∙e∙s simulé∙e∙s, salle de haute technologie avec des mannequins de haute-fidélité), elle doit donc être bien évaluée avant d’être proposée plus largement.
À votre avis, quels seront les principaux défis et tendances qui façonneront la formation dans les établissements hospitaliers au cours des prochaines années?
De mon point de vue, il faut avoir une réflexion sur les environnements de travail: il est nécessaire de les penser comme des écosystèmes. Il ne sert à rien de réinventer des théories pédagogiques si, en activité, les apprenant∙e∙s n’ont ni le temps ni la sécurité psychologique nécessaires permettant de questionner leurs pratiques et celles des autres.
La difficulté est d’établir les liens entre les aspects théoriques, issus des domaines disciplinaires des sciences médicales et infirmières, et les aspects pratiques, qui eux aussi sont issus de domaines scientifiques comme les sciences de l’organisation, la psychologie du travail et la sociologie.
Quand j’imagine le futur de la formation en milieu hospitalier, je dois avouer que je ne suis pas très à l’aise. La pression exercée par les enjeux liés au financement des systèmes de santé est telle que l’avenir ne me paraît guère réjouissant.
Enfin, je pense que l’intelligence artificielle va amener des déplacements majeurs dans l’organisation du travail. Le changement d’outil influence la pensée. En matière de formation, les supports cognitifs seront sans limite et je me questionne sur les changements que cela va amener sur la capacité d’analyse, de réflexion et donc les compétences des individus. Garderons-nous les compétences d’innovation, d’adaptation, de changement, de critique dans nos écosystèmes ou ferons-nous confiance à l’IA qui ne manquera pas de nous persuader que ce qui est proposé est forcément l’optimum?
Comment envisagez-vous l’équilibre entre formation académique et apprentissage en milieu hospitalier pour garantir une préparation optimale? Y a-t-il des aspects à améliorer?
Nous cherchons, dans les milieux cliniques, à trouver l’équilibre optimal entre les soignant∙e∙s du niveau tertiaire et du niveau secondaire pour assurer des soins de qualité. Cet équilibre doit se retrouver dans le nombre de stagiaires du niveau tertiaire et ceux du secondaire que nous formons dans nos services. L’idéal est de favoriser des apprentissages en partenariat sur le terrain en proposant l’apprentissage par les pair∙e∙s. Par exemple, au CHUV, nous déployons actuellement un projet qui prévoit des enseignements cliniques commun avec des étudiant∙e∙s HES et des apprenti∙e∙s ASSC; ces enseignements sont supervisés une fois par le Praticien Formateur (PF) et l’autre par le Formateur En Entreprise (FEE).
L’idée est toujours la même: se former ensemble; c’est un atout considérable dans le fonctionnement futur en tant que professionnel·le de la santé.
L’important est de (re)connaître les compétences des autres professionnel∙le∙s pour développer, avant d’entrer en activité, la capacité de gérer l’activité dans un milieu interdisciplinaire, interprofessionnel, dynamique et instable… Tout un programme! C’est un réel défi.

Quels sont, les principaux défis auxquels le CHUV doit faire face en matière de formation des professionnel∙le∙s de santé?
Le CHUV a pour mission de former les professionnel∙le∙s de la santé. Une des réponses à la pénurie de personnel est de former davantage. Cette solution nécessite d’avoir la capacité d’accueillir les personnes en formation dans un environnement de travail sain et serein. Ceci demande que le personnel d’encadrement soit non seulement formé pour cela mais qu’il ait également du temps dédié pour assurer un encadrement optimal. Les caractéristiques d’un environnement apprenant sont liées aux facteurs humains et organisationnels. Une situation d’apprenance est caractérisée par une problématique suffisamment complexe mais pas trop, dans un environnement de sécurité psychologique qui permet le droit à l’erreur tout en assurant la sécurité et la qualité des soins. L’ensemble des acteurs et actrices doivent reconnaître le statut de la personne en formation.
Pour le personnel en activité, la formation continue doit, pour toutes les raisons précédemment abordées, être principalement réfléchie pour favoriser le développement des compétences collectives et situées.
L’idéal est donc de pouvoir former en activité le plus grand nombre de personnes de manière synchrone; service par service. Cette manière de procéder a assurément un impact sur l’ensemble des acteurs et actrices donc sur l’interdisciplinarité et l’interprofessionnalité: ça se voit, ça se sent, ça se vit et ça a un impact sur l’Autre.
Mettre en place cette culture de la formation nécessite de travailler avec des objectifs critériés connus et partagés par l’ensemble des actant∙e∙s quel que soit leur niveau hiérarchique dans un écosystème (ce n’est pas partout le même besoin, ni la même solution qui doit être apportée).
Actions concrètes mises en place au CHUV
«Au CHUV, nous soignons l’accueil du nouveau personnel et plus particulièrement des primo-emplois, souligne Christine Theytaz. Nous considérons l’entrée en amont du jour J. L’encadrement de proximité prend contact avec la personne et lui offre la possibilité d’une rencontre dès l’engagement administratif. Puis, selon les secteurs, le temps de jumelage et le mentorat s’organisent jusqu’à deux ans après l’entrée en fonction. Nous visons un standard dans ce type d’accueil et sommes actuellement en phase pilote.
Par ailleurs, la mise en œuvre de l’article constitutionnel sur les soins infirmiers forts, qui se déploie avec le projet InvestPro pour le canton de Vaud, mène notamment une réflexion sur l’intégration des nouveaux∙lles diplômé∙e∙s et le continuum entre le temps de la formation et l’activité professionnelle réelle.
Nous sommes persuadés que garantir un environnement de travail qui promeut le leadership clinique et pédagogique est l’une des clés de réussite pour que notre personnel ait simplement envie de travailler au CHUV et soit fier du travail qu’il accomplit.»
Comment percevez-vous le rôle du CHUV dans l’évolution du paysage de la formation hospitalière en Suisse?
Le CHUV se positionne comme une institution de premier plan pour les innovations métier et de formation. Il a de tout temps désiré répondre aux besoins liés aux évolutions des formations professionnelles et académiques ainsi qu’aux réalités des environnements de travail. Pour ce faire, il s’est doté du Centre des Formation (Cefor) qui crée et dispense des formations qui répondent rapidement aux besoins du terrain. Le CHUV promeut également les formations initiales de haute qualité en misant sur les formations tertiaires (bachelor pour les soins infirmiers) tout en pensant l’équilibre des compétences (skill et grade mix) nécessaires à une prise en soins optimale, selon les spécificités des secteurs. Les formateurs et formatrices du terrain sont au bénéfice de compétences pédagogiques et créent ainsi un environnement d’apprentissage propice au développement des compétences.
De plus, le CHUV s’est positionné comme pionnier pour la pratique infirmière avancée; le canton de Vaud est, par ailleurs, le premier canton Suisse à se doter d’un cadre légal, ce qui permet le plein déploiement de cette pratique.
Photos: via Canva.com