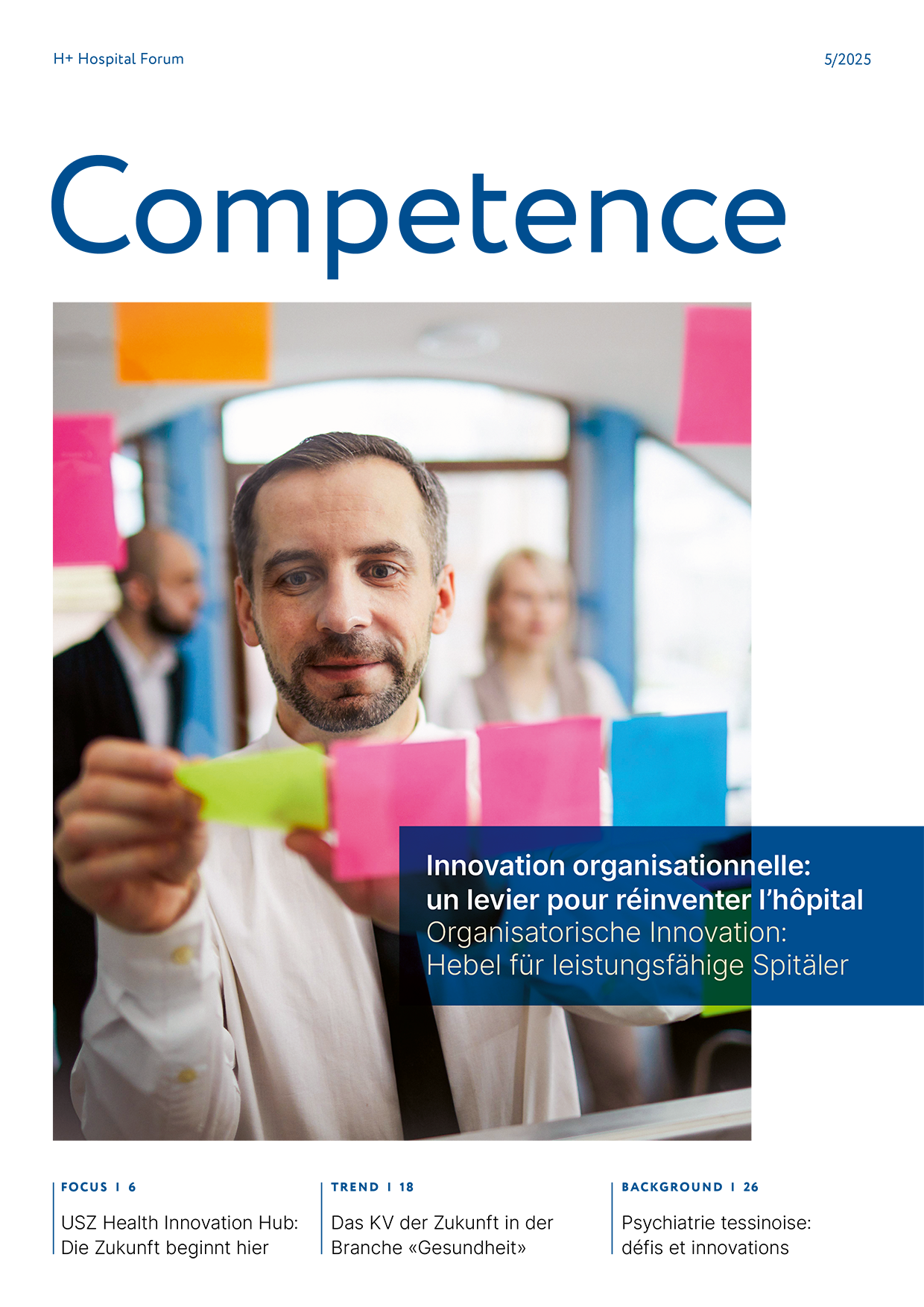6 min
6 minFocus Facteur temps
Délais et défis du recrutement médical en terres valaisannes
Quel délai faut-il compter pour recruter un·e soignant·e?
Grégory Quirino: Pour les postes médicaux, nous avons des délais inhérents aux spécifications cantonales. Pour les médecins-cadres, par exemple, il y a des contingents à respecter. Si l’on parle spécifiquement de remplacer une fonction soignante, en tenant compte du plein emploi actuel dans ce secteur, nous devons compter entre quatre à six mois de délai, ce qui comprend l’identification d’un besoin de recrutement, la mise en route du processus et le délai de congé standard qui est de trois mois.

Est-il possible de compresser ce délai?
GQ: De manière interne, on peut gagner en efficience en effectuant de la gestion prévisionnelle. Même si le poste n’existe pas encore, nous pouvons publier des annonces dans des domaines où nous avons des difficultés à recruter. Nous essayons également de gagner en efficacité en négociant avec la·le candidat·e afin qu’elle·il puisse bénéficier d’une réduction du délai de congé.
C’est souvent compliqué, car l’ensemble du marché est sous pression, les employeurs sont moins enclins à libérer leur personnel plus rapidement.
Etant donné la pénurie de personnel, assiste-t-on à une guerre entre établissements pour s’arroger les services des soignant·e·s?
GQ: Avec les hôpitaux frontaliers, la concurrence est présente oui. Pour les hôpitaux qui sont dans d’autres régions de la Suisse, une collaboration peut s’installer, mais cela reste exceptionnel. Dans la majorité des cas, nous mettons en avant nos points forts pour faire pencher la balance de notre côté, au-delà du seul aspect salarial, qui est lié à la politique cantonale.
Il est devenu primordial de recruter aujourd’hui avec beaucoup plus de créativité en se demandant ce qui est le plus attractif pour le personnel.
Dans notre établissement, nous vendons aussi la région. A l’aide d’institutions publiques comme Valais4You, on facilite la venue dans le canton pour celles et ceux qui souhaiterait s’y établir.
Pour quelqu’un qui vient de l’étranger, les délais d’attente sont d’autant plus importants…
GQ: Effectivement, la complexité suisse d’établissement, d’obtention d’autorisations de séjour, de travail, de regroupement familial peut faire peur. Certaines autorisations sont cantonales, d’autres fédérales. Le système dans son ensemble est très complexe. Pour obtenir un permis de travail lié à un permis de séjour, les délais peuvent aller de trois à six mois. En Valais, le service des migrations a du retard, cela à une incidence forte en termes de délai de recrutement.
Madame Fornage, dans votre secteur, vous recrutez non pas des soignant·e·s, mais du personnel médico-technique. Les défis sont-ils les mêmes?
Yasmina Fornage: Oui, avec une problématique supplémentaire. Notre défi est de rendre davantage attrayants nos métiers, notamment de laboratoire, qui restent relativement peu connus du grand public. Les postes de technicien·ne·s en analyses de laboratoire se raréfient, des écoles ferment leurs portes: de moins en moins de candidat·e·s sont sur le marché. Nous essayons de prendre des stagiaires le plus régulièrement possible: c’est en étant une entreprise formatrice que l’on démontre sa capacité à attirer des talents.
Nous participons également à la journée de la médecine de laboratoire afin de faire découvrir les coulisses et d’en apprendre davantage sur les métiers essentiels à la santé publique.

Recruter est-il devenu stressant ?
YF: Oui, dans le sens où les délais qu’on nous demande ne peuvent pas être respectés. Ce sont des métiers proches des patient∙e∙s, essentiels pour assurer la qualité des soins.
Y a-t-il des algorithmes sur lesquels vous pouvez vous appuyer afin de faciliter la gestion des ressources humaines ?
GQ: Nous avons effectué une expérience dernièrement qui n’a malheureusement pas aboutie. Aude Calame, mon adjointe, a voulu développer un algorithme de prévision des démissions. Mais finalement, la validité prédictive n’était pas suffisante. Sur ce sujet, nous ne sommes pas encore prêts, mais c’est intéressant pour nous d’identifier les membres du personnel qui seraient susceptibles de quitter le CHVR.
La maturité actuelle de l’analyse de la donnée n’est toutefois pas encore adéquate pour pouvoir s’appuyer sur ce type de machine learning.
Je suis toutefois convaincu que c’est une piste pour l’avenir: déterminer à quel moment l’enrichissement professionnel et l’évolution, horizontale comme verticale font défaut est très intéressant dans une vision de fidélisation du personnel.
Contrairement à d’autres domaines, quelles sont les difficultés en termes de recrutement dans un établissement de soins?
GQ: L’hôpital ne s’arrête jamais. À aucune minute, à aucune seconde, 365 jours par an. La pression de conformité est haute. On vit aussi le côté asynchrone du travail: il n’est pas rare de recevoir des courriels d’un·e infirmière·er en plein milieu de la nuit. La technologie, à l’avenir, devrait pouvoir nous soutenir à ce niveau. Je pense notamment au développement d’un ChatBot, qui pourrait renseigner les demandes portant sur le nombre jours de congé, les horaires, etc.
YF: Depuis mon arrivée, il y a cinq ans, je constate que la pénurie s’aggrave de plus en plus pour les secteurs de la pharmacie et du laboratoire. Bien sûr, il y a des contraintes à travailler à l’hôpital du point de vue des horaires. Il y a aussi un sens profond dans ces professions, mais j’ignore si cela est suffisant face aux attentes des générations actuelles, qui recherchent, à juste titre, un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le temps partiel est une normalité chez nous, ce sont souvent des métiers où l’on vit des événements intenses, il y a cette nécessité à pouvoir se ressourcer.
Justement, les temps partiels posent-ils des problèmes au niveau de la gestion RH ?
YF: Non. La seule différence, c’est que l’on a davantage de personnes à prendre en compte, donc plus de situations individuelles. Mais d’un point de vue technique, ce n’est pas forcément quelque chose de négatif. Pour les collaborateurs∙trices avec un taux d’activité très bas, cela est peut-être plus compliqué pour eux de rester à jour dans leurs connaissances, car ces professions nécessitent des formations continues importantes.
GQ: Aujourd’hui, le temps partiel est effectivement une nécessité. Deux personnes à 50% font deux fois plus de travail qu’une personne à 100%. Toutefois, d’un point de vue organisationnel, cela ouvre des perspectives, pour autant qu’il y ait une certaine flexibilité sur les horaires. Dans ce contexte, les CCT ont parfois des textes désuets face à la réalité du terrain. Aujourd’hui, l’un des défis qui nous animent est de mettre d’accord toutes les parties prenantes sur la définition du temps partiel et la flexibilité des horaires.
Photo de titre: Au CHVR comme à l’Institut central des hôpitaux (photo), les défis liés au recrutement de personnel qualifié sont nombreux (crédit photo: Hôpital du Valais).