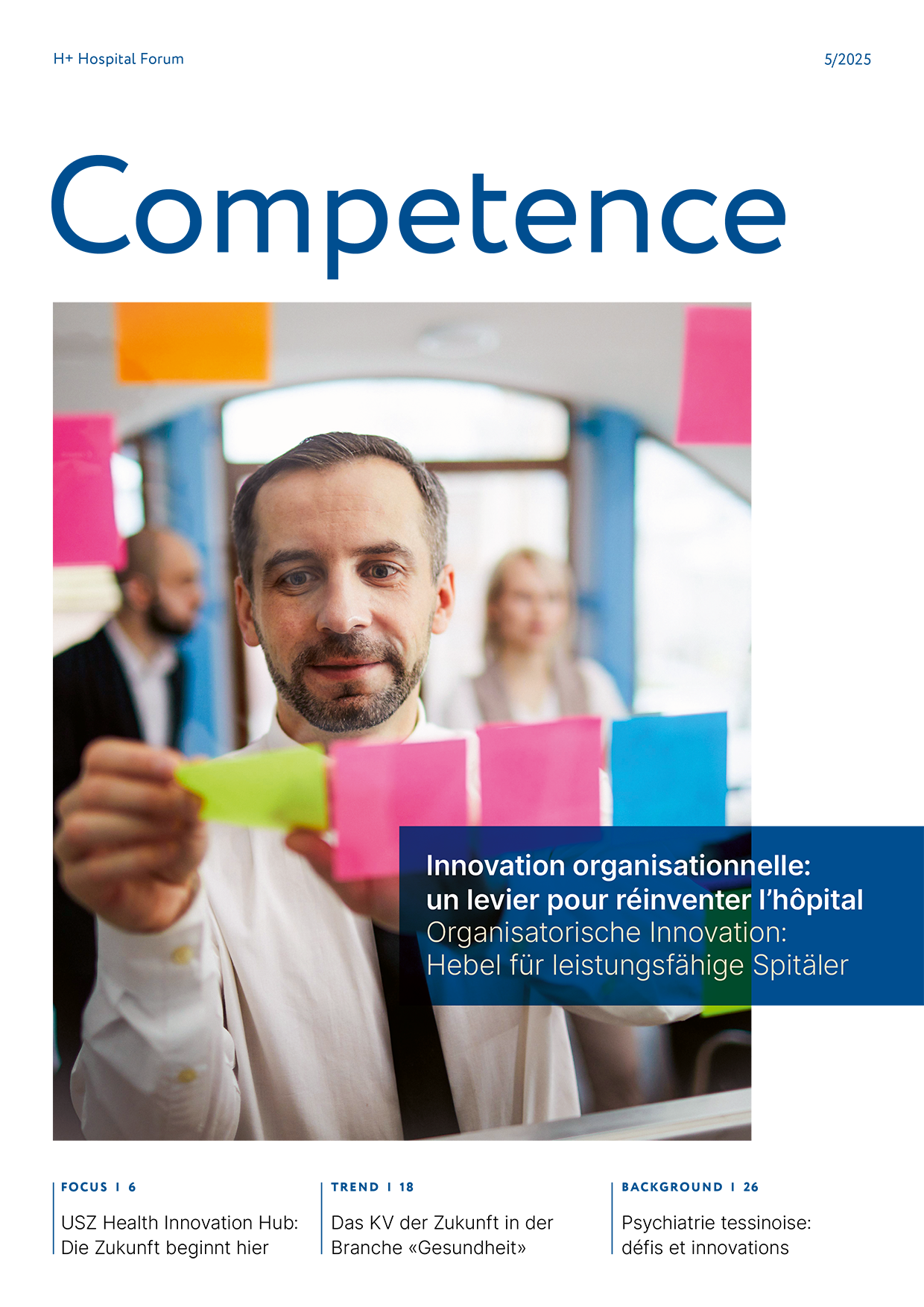4 min
4 minHôpitaux universitaires de Genève (HUG)
«Chaque été, les réserves de sang sont sous pression»
Quelle est l’ampleur de la pénurie actuelle à Genève?
Nous ne faisons pas face à une pénurie actuellement. Néanmoins, les mois de juillet et août représentent systématiquement une période critique pour le Centre de transfusion sanguine. C’est pourquoi nous veillons à augmenter les stocks dès le mois de juin. Les poches de globules rouges se conservent 42 jours, tandis que les plaquettes, indispensables aux patient∙e∙s souffrant de leucémie ou d’hémorragies sévères, ont une durée de vie de seulement 7 jours. Ce type de don est particulièrement sensible, le flux est constamment tendu.

Vous arrive-t-il de devoir reporter certaines interventions en raison d’un manque de sang?
C’est extrêmement rare, mais cela peut arriver dans les cas de pénurie critique. Lorsqu’on n’a plus de marge de manœuvre pour faire face à des urgences imprévisibles, on peut être contraints de différer des chirurgies à fort risque hémorragique. Ce n’est jamais une décision prise de gaieté de cœur, mais cela peut s’avérer nécessaire. C’était le cas, par exemple, lors du week-end de l’Ascension.
Comment éviter ces situations de stress pour l’hôpital?
Nous essayons d’anticiper ces périodes en incitant les donneurs∙euses à venir avant leur départ en vacances. Nous organisons aussi des campagnes autour de dates symboliques comme le 1er août. C’est une problématique récurrente dans toute la Suisse: l’été et les fêtes de fin d’année sont des moments particulièrement vulnérables pour les centres de transfusion.
Existe-t-il une coordination entre les hôpitaux romands pour gérer les stocks de manière solidaire?
Oui, absolument. À Genève, nous sommes les seuls à disposer d’un service de transfusion intégré à l’hôpital. Cela nous permet une vision directe des besoins et une plus grande réactivité. Mais notre canton souffre aussi d’un manque chronique de donneurs∙euses. Depuis des décennies, nous sommes aidés par d’autres services régionaux comme ceux de Neuchâtel-Jura ou de Fribourg.
Chaque semaine, nous recevons des livraisons en provenance de ces cantons. Sans cette solidarité, nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner.
Comment expliquer cette singularité genevoise?
Il existe un fort déséquilibre entre les besoins et la capacité de don de la population. Les HUG réalisent beaucoup d’interventions à haut risque hémorragique: greffes, soins de leucémies, etc. Ce sont des activités très consommatrices en produits sanguins. À l’inverse, des cantons comme Fribourg, le Jura ou Neuchâtel disposent d’un vivier de donneurs∙euses plus large que leurs besoins.
Les besoins en transfusion ont-ils évolué aux HUG ces dernières années?
Ils sont restés globalement stables sur les dix dernières années. Certaines chirurgies, comme l’orthopédie, requièrent aujourd’hui moins de sang, grâce à des techniques de récupération. Mais dans d’autres domaines (réanimation, polytraumatismes, transplantations) les besoins restent élevés. Nous traitons aussi de plus en plus de patient∙e∙s âgé∙e∙s atteints de leucémie. Cela compense les réductions ailleurs.
Comment expliquez-vous le fait que seulement 2,5 % de la population active donne régulièrement son sang en Suisse?
Ce chiffre montre qu’il y a un immense potentiel inexploité. L’une des principales difficultés est la disponibilité des donneurs∙euses, mais aussi le manque d’information. Beaucoup oublient qu’il n’existe aucun substitut au sang et que les besoins ne faiblissent pas.
À Genève, nous avons enregistré mille dons de moins en 2024 qu’en 2023, passant de 14’000 à 13’000. Nous devons faire mieux.
Quelles mesures avez-vous prévues pour relancer les dons?
Nous devons clairement moderniser notre communication. Les supports classiques comme les banderoles ou les affiches ne suffisent plus. Il faut investir les réseaux sociaux, qui permettent une communication plus ciblée et plus réactive. La moyenne d’âge des donneurs genevois est de 44 ans: pour assurer l’avenir, il faut mobiliser les 18–44 ans.
Que diriez-vous à une personne qui hésite à donner son sang?
Je lui dirais que nous manquons de sang et que nous avons besoin de tous les groupes sanguins. Certaines personnes développent des anticorps très rares et nécessitent des produits hyper spécifiques. Le sang est irremplaçable. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons répondre à toutes les urgences et sauver des vies.
Photos de titre: Centre de transfusion des HUG (crédit photo: HUG).